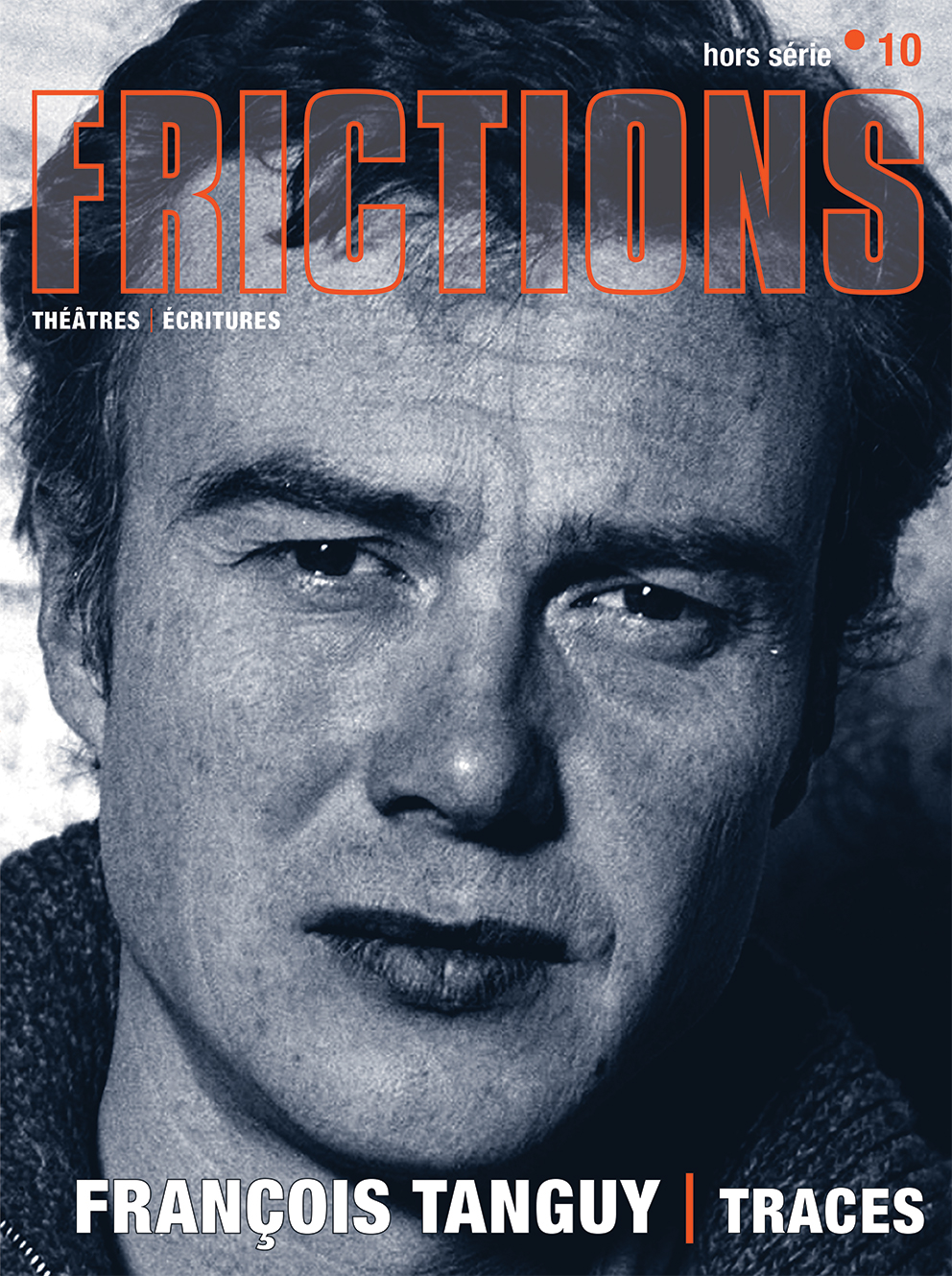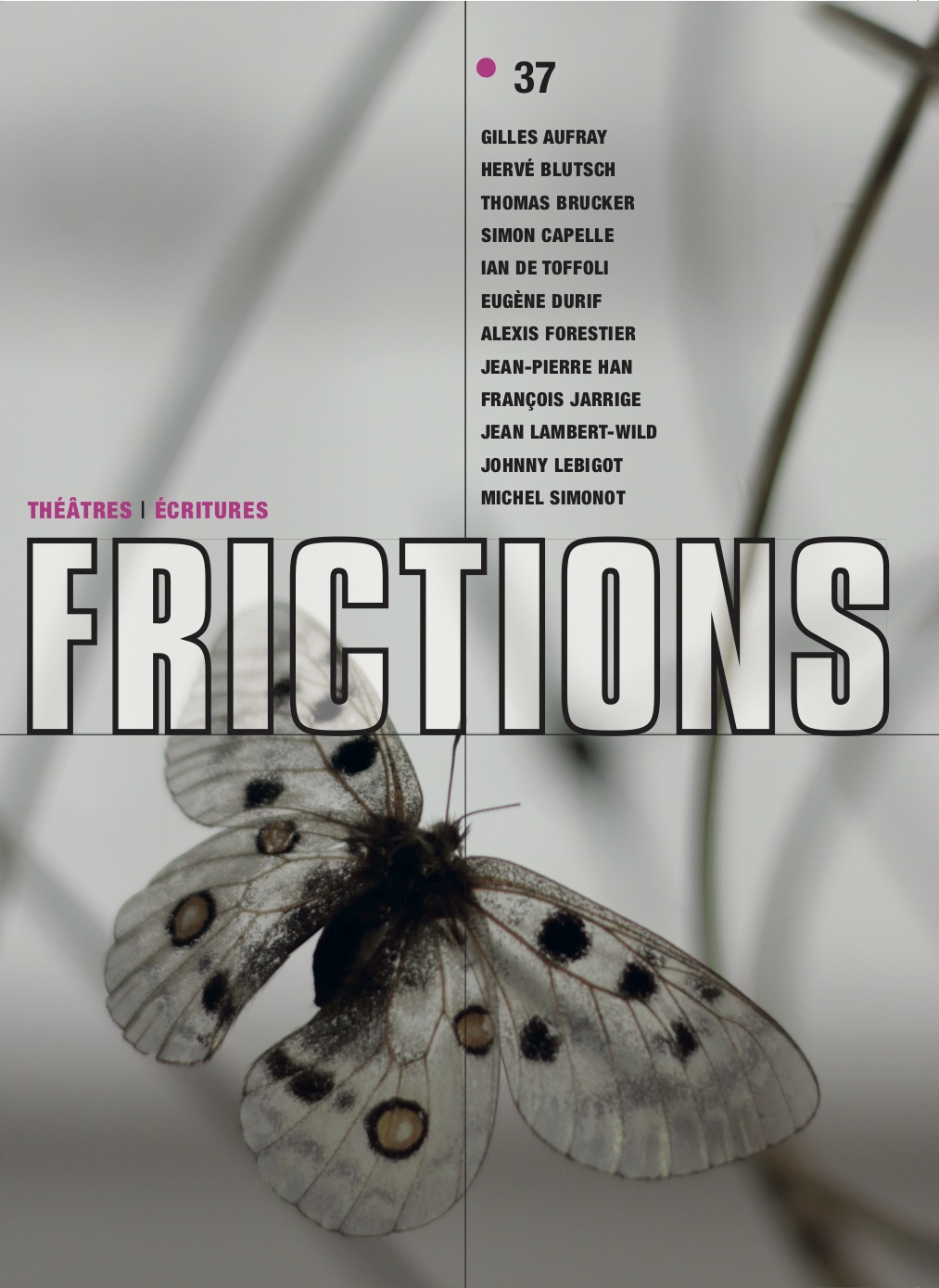Théâtre d’aujourd’hui ?
L’Éveil du printemps de Frank Wedekind. Théâtre national de la Colline. Jusqu’au 16 avril. Tél. : 01 44 62 52 52.
Le hasard auquel je ne crois décidément guère a mené mes pas, ces dernières semaines, vers des spectacles de jeunes créateurs qui présentent la caractéristique d’avoir de nombreux points communs entre eux. La tentation est grande dès lors de considérer ces spectacles comme emblématiques d’un certain état d’esprit de la société même dans laquelle nous vivons et que, pour quelques-uns d’entre nous, nous sommes contraints de subir. Il importe peu, à vrai dire, que ces productions soient réussies ou pas, qu’elles opèrent dans des registres différents, elles existent et sont les révélateurs de notre époque qui s’y reconnaît tellement qu’elles leur font, d’une manière générale, un excellent accueil qui me laisse toujours perplexe. Dernière réalisation scénique en date, L’Éveil du printemps de l’allemand Frank Wedekind, l’auteur de Lulu, mis en scène par Guillaume Vincent, dont le tout petit milieu du théâtre, une poignée, ne cesse de tresser les louanges depuis sa sortie du Théâtre national de Strasbourg alors dirigé par Stéphane Braunschweig, désormais directeur du théâtre de la Colline qui l’accueille aujourd’hui. À la conquête d’un public un peu plus vaste. Opération qui risque de marcher s’il faut en croire certaines réactions dont celle plutôt outrancière de la journaliste du Monde qui, dans son enthousiasme ne se rendit même pas compte que si les comédiens ne saluaient pas lors de ce qu’elle pensait être la fin du spectacle, c’était tout simplement parce que ce n’était que l’entracte ! Auparavant cette critique avait eu l’honnêteté de prévenir qu’il valait mieux ne pas lire le texte de Wedekind avant de voir le spectacle. Utile précaution : on se demande en effet où est passée l’œuvre de l’auteur. Précédée d’un prologue inventé de toute pièce (mais pourquoi pas ?) il faut attendre dix bonnes minutes avant que le premier mot de Wedekind soit prononcé. On respire d’aise alors ? Non pas, car le texte est joué à l’énergie, ou plutôt à la sur-énergie, qui tient lieu de style, voire de pensée dramaturgique. Les jeunes comédiens (car on joue bien sûr de la jeunesse, ce qui tombe plutôt bien pour cette pièce qui met en scène des adolescents) s’en donnent à cœur joie, mais pour quel enjeu ? D’autant que chacun est un peu livré à lui-même, rapidement dirigé, et l’on retrouve dès lors, paradoxalement, un jeu qui sous des dehors de modernité est plutôt classique, tradition pas morte. Cette manière d’investir la scène, d’y plaquer un schéma de dramaturgie qui ne reste qu’un schéma n’est pas sans rappeler le Woyzeck d’après Woyzeck de Gwenaël Morin vu au théâtre de la Bastille quelques jours auparavant… Spectacle dont la seule idée directrice est que le personnage de Woyzeck est fou… ce qui est tout de même plutôt réducteur, mais qu’importe là aussi l’agitation tient lieu de pensée. La production des signes dans un spectacle comme dans l’autre est pauvre, parfois grossière, ou naïve, soyons charitables, dans leur évidence. Elle n’aide jamais à la construction d’une véritable dramaturgie. Ce n’est pas faute de « pensée », mais celle-ci est émise hors plateau. L’entretien de Guillaume Vincent avec sa scénographe Marion Stoufflet dans le programme est plutôt réjouissant. Freud, Lacan, Bergman, Kantor, Nietzsche et Proust sont cités… Quant à Gwenaël Morin, on connaît son bagout. La réalité du plateau, malheureusement, les rappelle parfois à l’ordre. Cette réalité est celle d’un vide sidéral (malgré l’agitation, malgré le remplissage – l’encombrement – volontaire de la scène). Restent alors sur le plateau une série de tics, oripeaux de la modernité, qui font sourire ; le savoir-faire et les citations ou emprunts qui ne disent pas leurs noms, tiennent lieu d’inspiration. Cela en devient, comme dans le Woyzeck, ou dans Le père Tralalère de Sylvain Creuzevault, un autre « jeune » à la mode, pathétique. Ce type de spectacle ressortit au même titre que les productions d’un Philippe Quesne (à nouveau programmé cet été au festival d’Avignon), mais de manière bien sûr différente, à ce que l’on pourrait nommer une esthétique du vide. Le vide d’une société d’économie libérale très avancée qui ne cesse de se chercher des alibis pour se donner l’impression de vivre, des alibis pour être en capacité de poursuivre son œuvre mortifère, et qui applaudit des deux mains à tout ce qui n’est qu’esbroufe. Au moins le travail du Moukden théâtre, Chez les nôtres, d’Olivier Coulon-Jablonka dont j’ai parlé avec sévérité le mois dernier, avait-il le mérite d’être d’une parfaite sincérité, dans la recherche d’une véritable langue politique. Les vagues d’après Virginia Woolf jadis monté par Guillaume Vincent, dans sa maladresse même, pouvait laisser espérer mieux de la suite des événements, mais ce n’est qu’un lointain souvenir.
Jean-Pierre Han