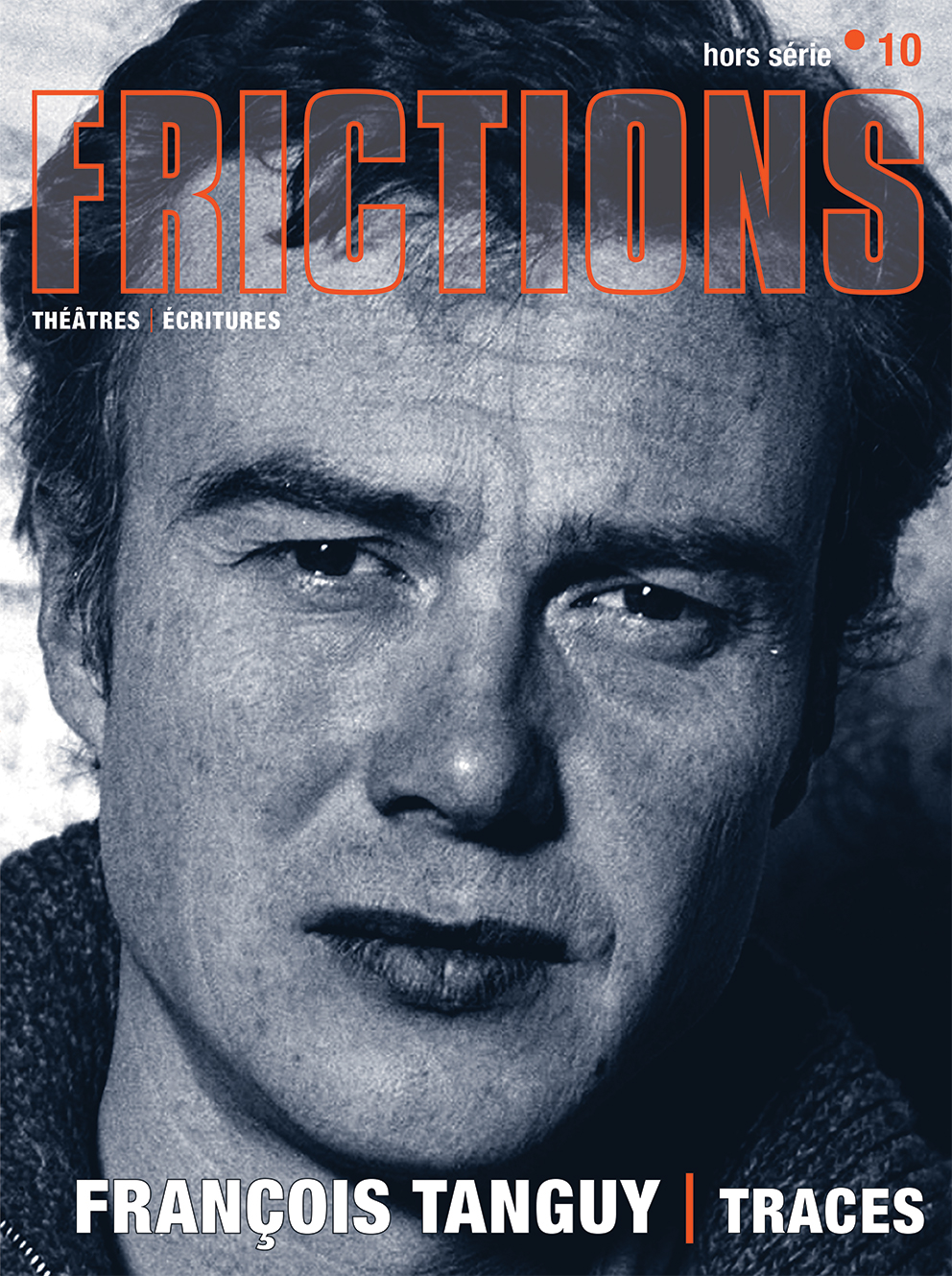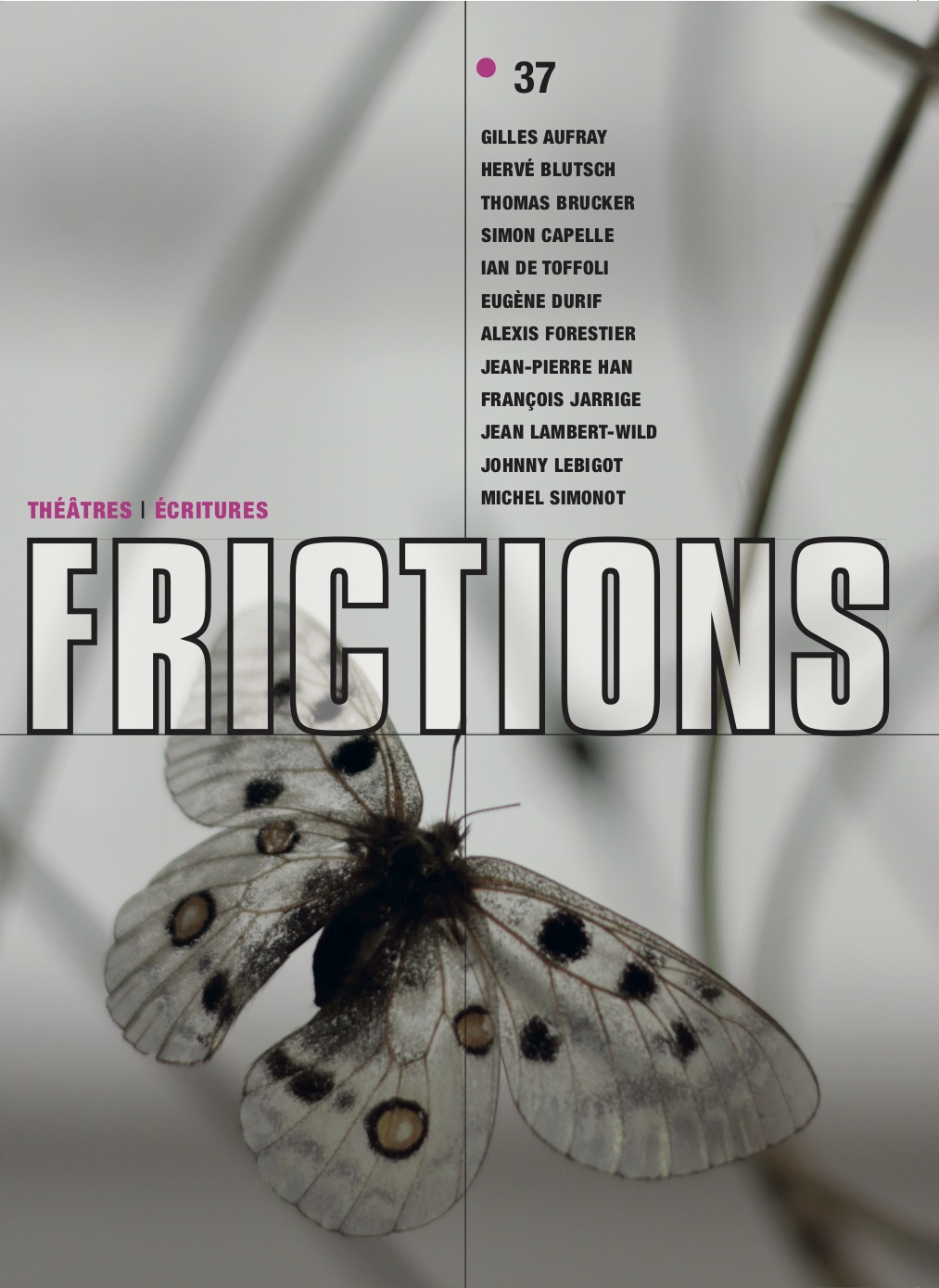"Final cut" pour ouvrir le chemin de la vie
Final cut de et par Myriam Saduis. Théâtre de Belleville à Paris. Jusqu’au 27 novembre à 19 heures. Tél. : 01 48 06 72 34. theatredebelleville.com
La réussite du spectacle de Myriam Saduis, Final cut, tient dans le parfait équilibre de ses différents registres et composantes. Pour le dire vite il marie à merveille l’intime et le politique, si on se tient à ces deux seuls éléments fondamentaux, là où justement nombre de propositions qui en font l’annonce échouent, ne parvenant pas à fouiller l’un et à œuvrer de manière efficace dans l’autre, restent définitivement à la surface des choses. En un mot, Final cut, jusque dans son titre reprenant et mettant un point final au parcours proposé, est d’une parfaite cohérence, alors que tous les éléments décrits et détaillées par son autrice, metteure en scène et interprète tout à la fois, pouvait faire naître des doutes sur leur possible agencement et leur mise en spectacle. Avec déjà, au départ, un « roman » familial presque trop parfait dans ses événements pouvant alimenter un pathos hors de propos. Que l’on en juge : Myriam Saduis – et déjà commence la saga, puisque Saduis est la transformation occidentale et officiellement autorisée voulue par sa mère de son vrai nom arabe celui-là, Saädaoui – est née d’un mariage d’amour entre une jeune italienne dont les parents sont installés en Tunisie alors sous protectorat français et un autochtone, Béchir. Après maintes péripéties (retour de la mère dès sa majorité pour retrouver l’homme qu’elle aime et l’épouser) tout le monde, grand-parents, parents et enfant se retrouve en Bourgogne où a émigré la famille. Une difficile cohabitation puisque le mari est à peine toléré (reconnu ?) par sa belle famille laquelle se réjouira sans doute de sa disparition car le couple finit par se séparer : la petite Myriam qui est née en France n’entendra plus jamais parler de son père, effacé de toute conversation, de toute mémoire, (l’enfant est bien trop jeune à son départ), photos effacées, une véritable disparition.
C’est cela – le récit de cette disparition, sa recherche psychique du père ou de son image lorsqu’elle sera en âge de la faire que narre Myriam Saduis. Ici intervient l’évocation de son parcours psychanalytique, elle qui n’a « découvert qu’à 40 ans dans quelles circonstances s(ma)a naissance a eu lieu », c’est-à-dire à l’orée des années 2000. C’est ce cheminement avec tous ses méandres dont Myriam Saduis nous fait part avec une extrême précision, en ce qui concerne notamment les dates dès lors qu’elle indique au spectateur celle de sa naissance, 1961, une manière de situer les choses historiquement. Car tout cela se passe, lors d’une sorte de conférence que réalise l’actrice, assise à sa table aux multiples tiroirs (secrets ?) en s’adressant directement au spectateur (« retenez cela, j’y reviendrai tout à l’heure »). 1961 justement, c’est l’année du massacre d’algériens lors d’une grande manifestation par la police parisienne aux ordres du préfet Maurice Papon. Un massacre au cours duquel plus d’une centaine de manifestants sont tués et pour un bon nombre d’entre eux jetés dans la Seine. 1961 c’est aussi, en Tunisie, un autre massacre celui de Bizerte perpétré par l’armée française cette fois-ci… De manière plus secrète, ce qui est mis au jour c’est la nature des relations entre colons et colonisés, ceux de « la race inférieure », pour reprendre l’hallucinante expression de Jules Ferry dans un discours dont l’autrice nous donne lecture.
Par-delà ou en deçà c’est la figure de la mère (« merveilleuse et paranoïaque ») qui est mise en exergue, première victime du racisme ordinaire et dont la seule échappatoire aura sans doute été la folie. Le récit de Myriam Saduis commence d’ailleurs par l’annonce d’une « fugue » de sa mère avant qu’elle ne soit retrouvée, enfermée et qu’elle ne meure. Alors seulement sans doute Myriam Saduis, l’enfant née d’une transgression, peut-elle commencer son récit jusqu’à son achèvement (Final cut), refusant presque de faire théâtre ou spectacle, refusant tout autant de faire conférencière, assise dans une attitude volontariste, avec des gestes entre grâce, raideur et brusquerie – c’est étonnant et d’une belle efficacité – se laissant quand même aller dans l’évocation (avec Pierre Verplancken en alternance avec Olivier Ythier) d’une scène de La Mouette, une pièce dont elle a autrefois présenté une adaptation intitulée de manière plutôt parlante, La Nostalgie de l’avenir… Car, voyage psychanalytique achevé, c’est bien vers le théâtre – l’avenir ? – que Myriam Saudis se sera tournée, et c’est bien nous, spectateurs, qui en profitons.