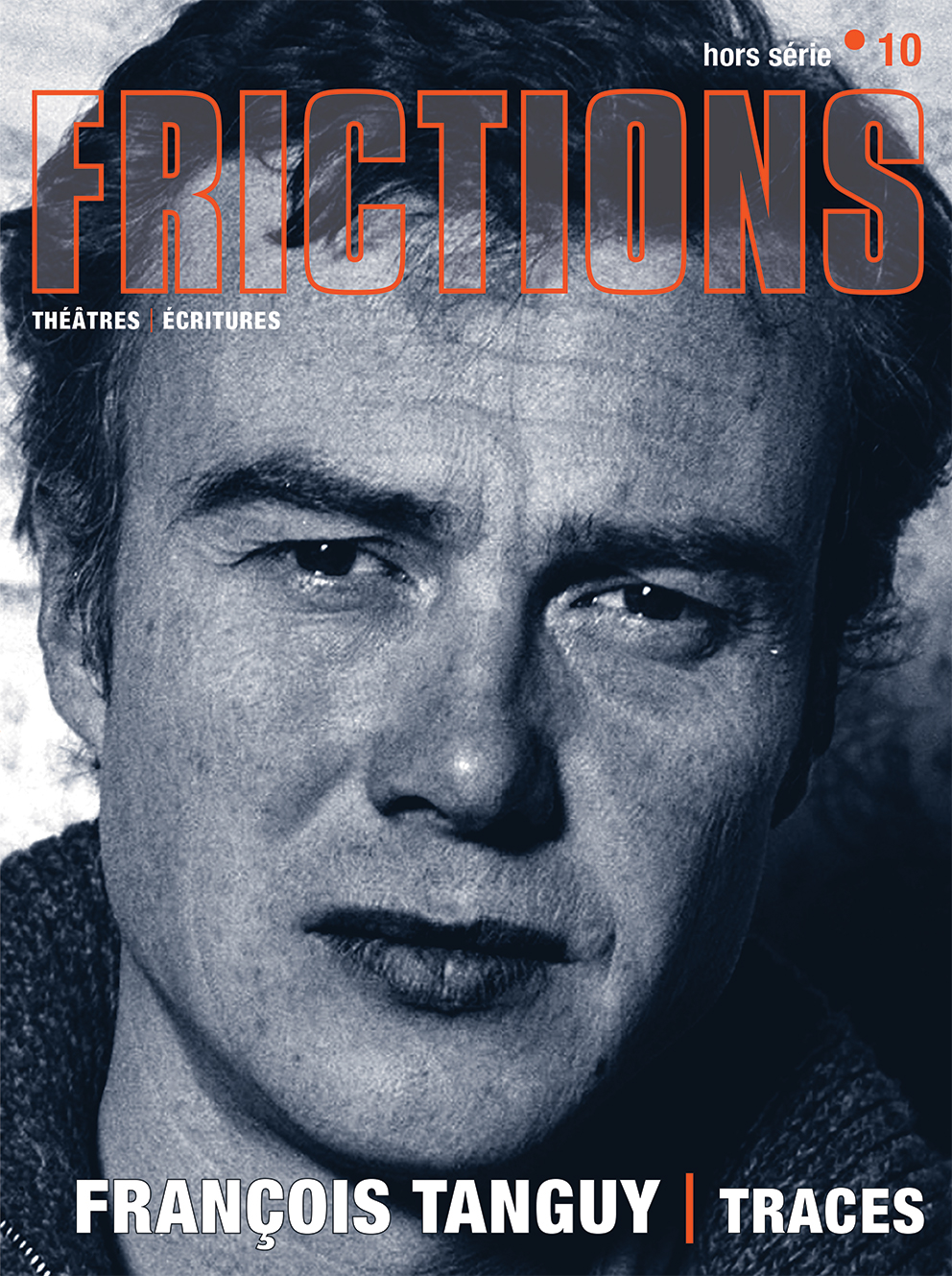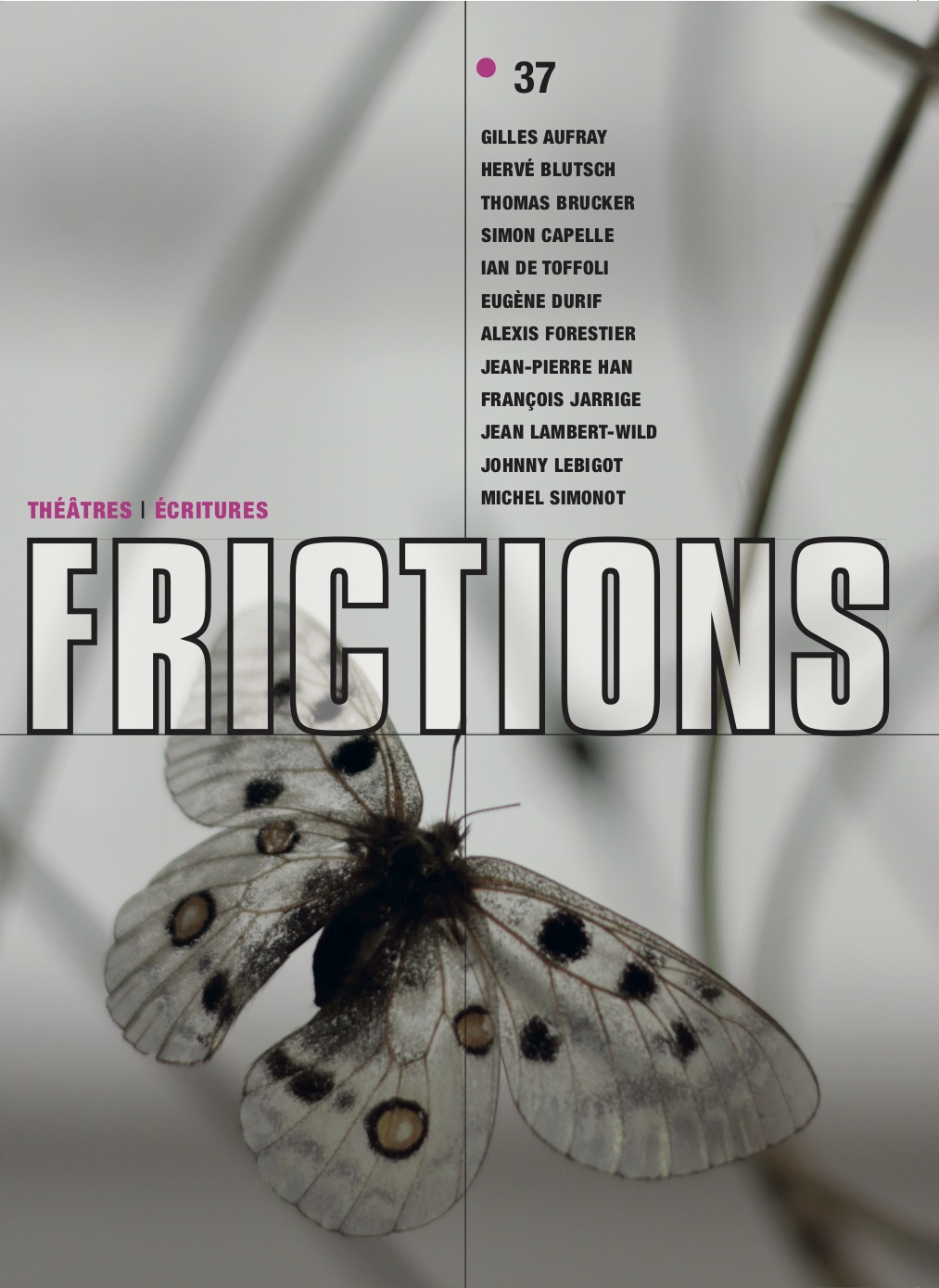Une lettre d’amour au père
Qui a tué mon père d’Édouard Louis. Mise en scène et interprétation de Stanislas Nordey. Théâtre national de la Colline, jusqu’au 3 avril, à 20 h 30. Tél. : 01 44 62 52 52. Puis du 2 au 15 mai au Théâtre national de Strasbourg.
Sans point d’interrogation Qui a tué mon père, le titre de l’opus d’Édouard Louis que Stanislas Nordey porte à la scène, devient une affirmation martelée dans sa dernière partie. Une accusation envers les politiques responsables de la mort du père, victime d’un accident de travail à son usine et qui le plongera dans la souffrance et un irréversible handicap : ils sont clairement nommés jusqu’à plus soif, de Chirac à Macron, en passant par Sarkozy et son complice Martin Hirsch pour ce qui est de l’abrogation du RMI, et Hollande (quant à évoquer à leur propos la figure d’un Richard III, c’est pour le moins osé encore que très… théâtral !). Ils sont donc interpelés, mais l’essentiel de l’œuvre d’Édouard Louis n’est-il pas ailleurs ? Dans le « retour » de l’auteur vers ce père alcoolique et violent apparemment détesté au vu de leur histoire commune, mais qu’il finira par « découvrir » à la fin de sa vie. Qui a tué mon père est l’histoire d’un retournement, l’histoire d’un homme saisi dans la violence qui l’habite, notamment à l’encontre de l’auteur, mais aussi dans celle – sociale celle-là – qu’il subit. Écriture d’un retournement, Qui a tué mon père se développe donc clairement en deux parties. Avec l’histoire de la relation tumultueuse, violente, entre un père et son fils. La violence s’exerce dans le cercle familial, mère et frère de l’auteur participant à leur manière à l’infernal « jeu ». Terrible voire insupportable, dira-t-on, d’autant plus terrible que l’homophobie (« Pourquoi tu es comme ça ? Tu nous fait honte ») à l’encontre du narrateur ajoute encore, si besoin était, à l’horreur de la situation. Mais pour aussi infernale que soit la situation décrite qui mènera inéluctablement à l’éloignement et à la rupture entre le père et le fils, elle n’a malheureusement rien d’exceptionnelle : les témoignages de ce type – retournement de situation et rapprochement entre les deux protagonistes principaux compris – ne manquent pas à quelques variantes près. On comprendra néanmoins la nécessité pour l’auteur de reparcourir cette vie et d’écrire ce qui s’apparente à une lettre d’amour, pour enfin comprendre ce qui s’est véritablement joué. Mais qu’en est-il pour le lecteur (et le spectateur ?). L’écriture d’Édouard Louis ne fait pas, on l’a dit et c’est aussi ce qui a fait son succès dès son premier roman, En finir avec Eddy Bellegueule, dans la dentelle. D’une redoutable efficacité, elle reste dans le plus pur prosaïsme, sans grand style, ne parvenant ou refusant de s’élever vers ce qui, après tout, fait quand même les grandes œuvres théâtrales, quoi qu’en dise et en pense Stanislas Nordey qui est à l’origine de ce texte. Il y a tellement cru Stanislas Nordey que tout dans son travail scénique et son interprétation au demeurant plutôt convaincante tendent à prolonger avec une certaine munificence (vaste plateau nu, apparition de mannequins à l’effigie du père à chaque césure de la représentation, jeux de lumières, sons travaillés, beauté de la neige qui tombe, etc.) ce que le seul texte d’Édouard Louis ne donne pas. Était-ce la bonne solution ? On ne sait trop. Ce qu’en revanche nous savons, c’est que le spectacle, car spectacle il y a, laisse un réel goût de frustration.
Jean-Pierre Han