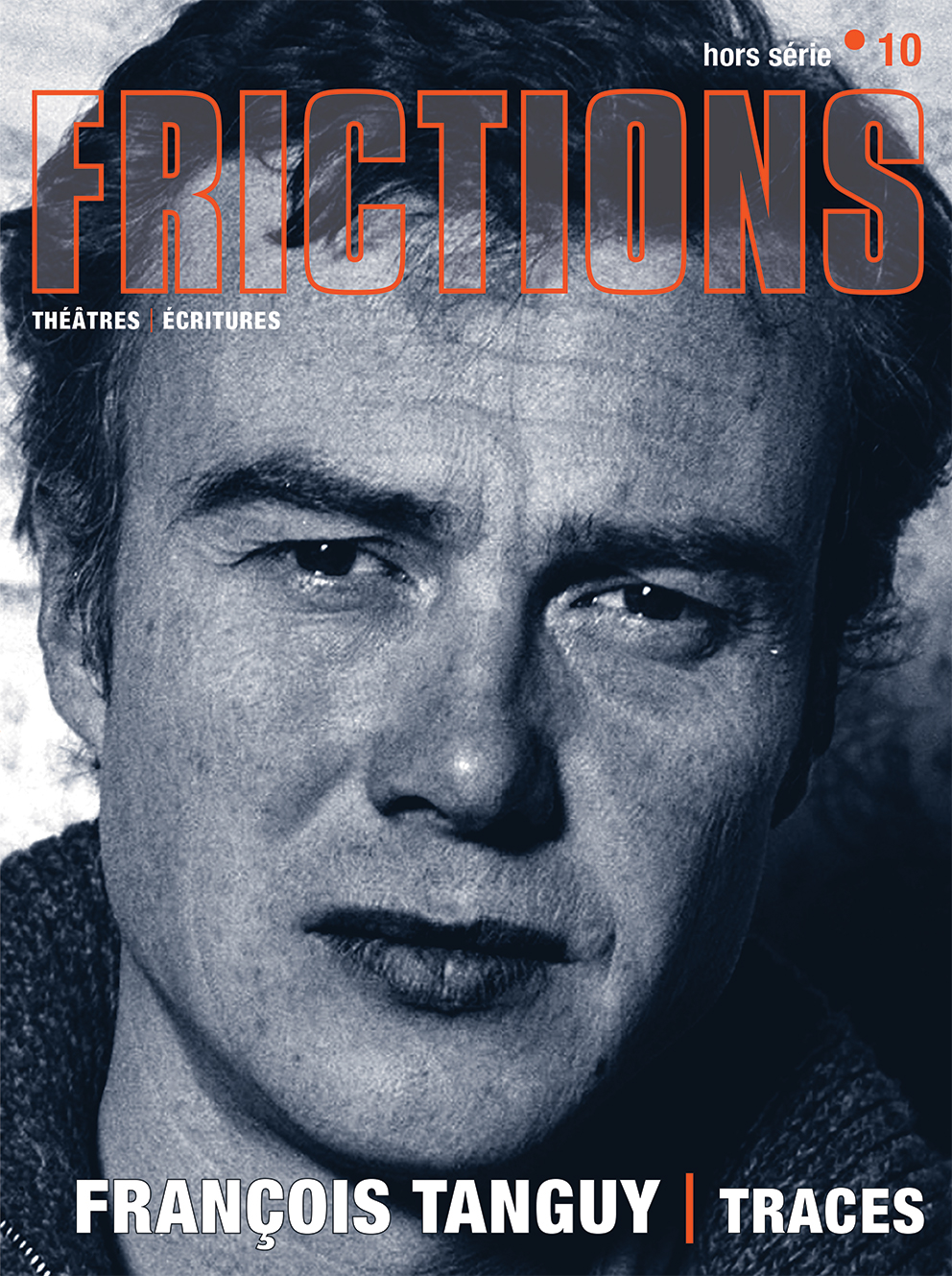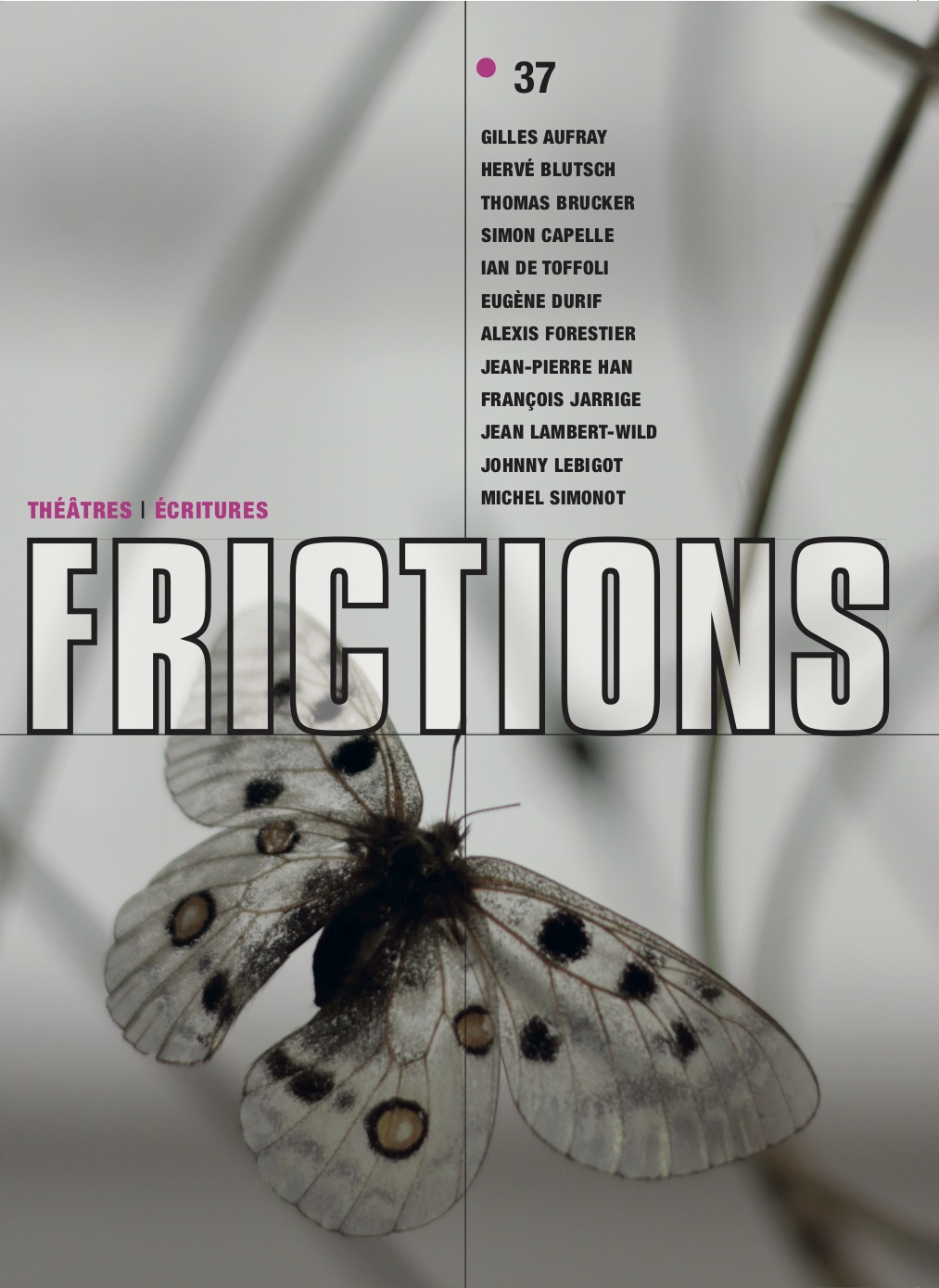Que reste-t-il ?
La Reprise, Histoire(s) du théâtre (1) de Milo Rau. Mise en scène de l’auteur. Théâtre des Amandiers-Nanterre. Festival d’automne. Jusqu’au 5 octobre à 20 heures 30. Tél. : 01 46 14 70 00.
C’est la question que l’on se pose à la sortie du dernier spectacle de Milo Rau. La salle est pleine, « comble », comme on dit – comblée, même, à la fin. Les spectateurs debout sont ravis de la promesse tenue après le « tabac » du spectacle au dernier festival d’Avignon. Un succès, donc. Et pourtant… Pourtant, à y regarder de plus près, certains applaudissements sont plus mesurés. Des visages restent sceptiques. À côté de ceux qui crient debout ou qui tapent du pied, d’autres spectateurs, plus discrets, se taisent. Leur silence en dit long.
La Reprise part d’un fait divers : la mise à mort d’un homosexuel en Belgique en 2012. À partir de ce sujet se développe une Histoire(s) du théâtre (1) qui commence donc par la tragédie. Ce qui est clairement expliqué par le premier comédien qui vient nous parler sur scène, préparant le parallélisme entre le sacrifice du bouc à l’origine de la tragédie antique (ce qui n’est toujours pas prouvé) et celui de l’homosexuel dans la pièce. Après cette longue tirade adressée directement au public, sur ce qu’est le théâtre, sur ce que « on » va faire et ce que « on » va voir – bien jouée au demeurant, avec une très pertinente insertion d’une scène de Hamlet, celle où le spectre surgit – le spectacle raconte la mise en scène de ce fait divers. Le spectacle se raconte et se joue lui-même, en même temps. Première manipulation. On se dit tout d’abord que du théâtre dans le théâtre, très shakespearien, très baroque, c’est très fort ! Oui mais. Avec ce spectacle et ses choix de mise en scène, Milo Rau questionne notre propre réception de la violence de notre monde d’aujourd’hui. En la mettant en scène, il nous met à l’épreuve jusqu’au bout. C’est intelligent et remarquablement bien fait. L’homme maîtrise la scénographie, l’écriture, le propos, les références. Pourtant, c’est profondément décevant. Si l’homme maîtrise la technique, que nous dit l’artiste ? Et à qui s’adresse-t-il ? La mise en scène de cette mise en scène, à force de se gonfler d’elle-même, de s’enfler, de se travailler, en crève. Parce que les scènes jouées sur le plateau sont doublées des mêmes scènes projetées à l’écran – tantôt prises en direct sur le plateau, tantôt avec des images tournées en amont identiques à celles du plateau, à quelques différences près. Redondance, et non dédoublement. Gonflement, et non réflexivité, ouverture et enrichissement du signe. L’écran crève le plateau, quand le propos devrait crever l’écran. Image de l’image, miroir de nous-mêmes, reflets baroques de notre propre fascination ? Le problème est que cela fascine, justement. De recul, de réflexion, point. La vidéo n’est pas traitée comme un matériau scénique, elle écrase le théâtre. Gênant, quand on raconte l’histoire du théâtre. Et l’on ne peut s’empêcher de penser à Cocteau affirmant que « les miroirs feraient bien de réfléchir davantage avant de renvoyer les images. » Celles de Milo Rau rappellent plutôt le miroir sans tain de froids interrogatoires de police. Car la froideur est omniprésente ici. La vulgarité aussi. Étalée, sans concession. « La violence brute », dit Milo Rau. Point de chaleur humaine, point de beauté, point d’élan. Que reste-t-il de l’art ? Alors que l’on nous parle (dans le programme) de « collectif » ? Est-ce à cela que l’on applaudit ? La première scène de l’histoire (une fois passée la mise en place et le énième avertissement que l’on va nous jouer du théâtre, avec étalage parfaitement maîtrisé de l’artifice montre les parents du jeune homosexuel au lit, le soir de sa disparition. Complètement nus. Deux corps dont l’un assez figé, celui de la mère, joué par une actrice qui joue une actrice (vous suivez ?), amateure à la retraite qui aime bien faire du théâtre (ce qu’elle a expliqué au début, dans une scène de casting de théâtre où on lui demandait si elle serait prête à se mettre nue – elle l’est dans la scène suivante, pas de « non » possible, donc. La question est : pourquoi ? Pourquoi cet accent sur cette nudité, qui n’est pas rien, mais qui est ramenée ici à une banalité triste d’où le sens semble absent. Un triste ab-sens, vide de sens. Creux. Le spectacle s’ouvre et se ferme d’ailleurs sur des projections de fumée : métaphore (de quoi ?) ou signe révélateur, malgré soi, d’une vacuité du sens ? Ironie du théâtre où le geste prétentieux du metteur en scène se retourne contre lui-même. Si la mise en scène se reflète autant elle-même, peut-être finit-elle par être son propre point de mire, prise au piège de ses propres miroitements ; contorsions constantes plus coquettes que signifiantes. Si ce n’était qu’une coquetterie, on pourrait en rire. Le problème est que le sujet est grave et, comme tout ce qui est grave, demanderait peut-être à être traité non avec une « violence brute », mais avec une certaine délicatesse. On est loin de Brokeback Mountain ou d’Orange mécanique, où Kubrick ne confond pas violence qu’il montre et violence du réalisateur. Milo Rau ne représente pas la violence, lui, il la reproduit. Pourquoi ?
Un peu plus tard, une autre scène montre les jeunes agresseurs (avant qu’ils ne tabassent leur victime) chez l’un d’eux, sur un canapé. L’un joue à un jeu vidéo (les jeux vidéos sont violents ; analyse fine et profonde, lumineuse et profonde prise de conscience chez le spectateur), l’autre pelote une fille juste à côté. Pelote jusqu’à lui glisser une main entre les cuisses, jusqu’au sexe. Pas de voyeurisme de détail pour autant, c’est plus malin que cela, mais la main est très visible. Encore une fois : pourquoi ? Qu’est-ce qu’on voit ? Qu’est-ce qu’on veut que nous voyions, que nous regardions ? Encore une fois, à qui s’adresse Milo Rau ? La scène de tabassage vient ensuite, qui commence dans la voiture dans laquelle est monté le jeune homosexuel ; un des agresseurs lui demande s’il veut « sucer une grosse bite ». Choc. Choc d’accablement. Les détails scabreux s’accumulent. On en est encore là ? À balancer en pleine visage du spectateur, en 2018, des mots et des images crus et vulgaires qui n’apportent rien que l’étalage d’une bassesse sans profondeur ? Qu’est-ce qu’on dit, avec cela ? Qu’est-ce qu’on veut faire bouger ? De quoi est-ce le signe ? On attend. Malaise quand les rires fusent au détour de certains clins d’œil. Puis vient la scène où le petit ami raconte en très gros plan avoir été surpris de ne pas avoir trouvé des salopards dans les agresseurs auxquels il s’est trouvé confronté au procès, mais de la « bêtise », « de gros cons ». On ne peut même plus dire ironiquement que l’écriture s’envole, tellement elle s’écrase, tellement elle écrase la langue. Le problème, c’est que cela n’est pas sans conséquence. Écraser la langue, c’est écraser la pensée. À mort le poète.
Alors, oui, vient la nausée. L’homophobie est ce qu’on appelle « un vrai sujet », et pas dans le sens médiatique du terme. Or, avec cette surexposition narcissique des moyens employés, on peut se demander si Milo Rau ne verse pas, finalement, dans le médiatique, ce qui pose quand même question pour un artiste. L’homophobie pose problème au sens profondément humain, car elle pose la question de l’intolérance et de la violence, de ce qu’on « viole », quand on déchaîne sa violence contre un autre. De cette piste de réflexion possible (sur ce que la violence contre l’autre peut révéler de violence contre soi), point de trace pourtant. Le spectacle continue de glisser, d’enchaîner des images, finalement bien-pensantes car elles n’amènent qu’à se dire que l’homophobie, c’est mal, au lieu de nous faire penser à ce qui s’y joue (et le jeu théâtral, justement, aurait pu, là, aider). Là est la nausée, la colère presque. Comment se contenter de cette accumulation d’images, jusqu’à saturation, comment (et pourquoi) une telle brutalité, un tel manque de finesse ? La mise en scène de Milo Rau est remplie d’intelligence des signes – on ne peut pas le soupçonner de la bêtise qu’il pointe. Mais que nous donne à penser cette maîtrise ? Rien. Il n’y a rien. Les homophobes qui tuent ne sont pas des salopards, mais de simples abrutis. Fin de l’histoire. C’est tout. C’est bien peu. On ne peut que s’interroger sur le caractère lisse, policé, conventionnel de ce spectacle si à la mode pourtant. On se demande bien à quel public il s’adresse. Quel est ce théâtre dont la bien-pensance s’exhibe dans toute sa brutalité ? Que sont devenus les Amandiers, les arbres en fleurs ? On se demande aussi où est le public de Nanterre…
Julie Grimoud
Voir la critique du 14 juillet dernier, à propos des représentations données au festival d'Avignon.