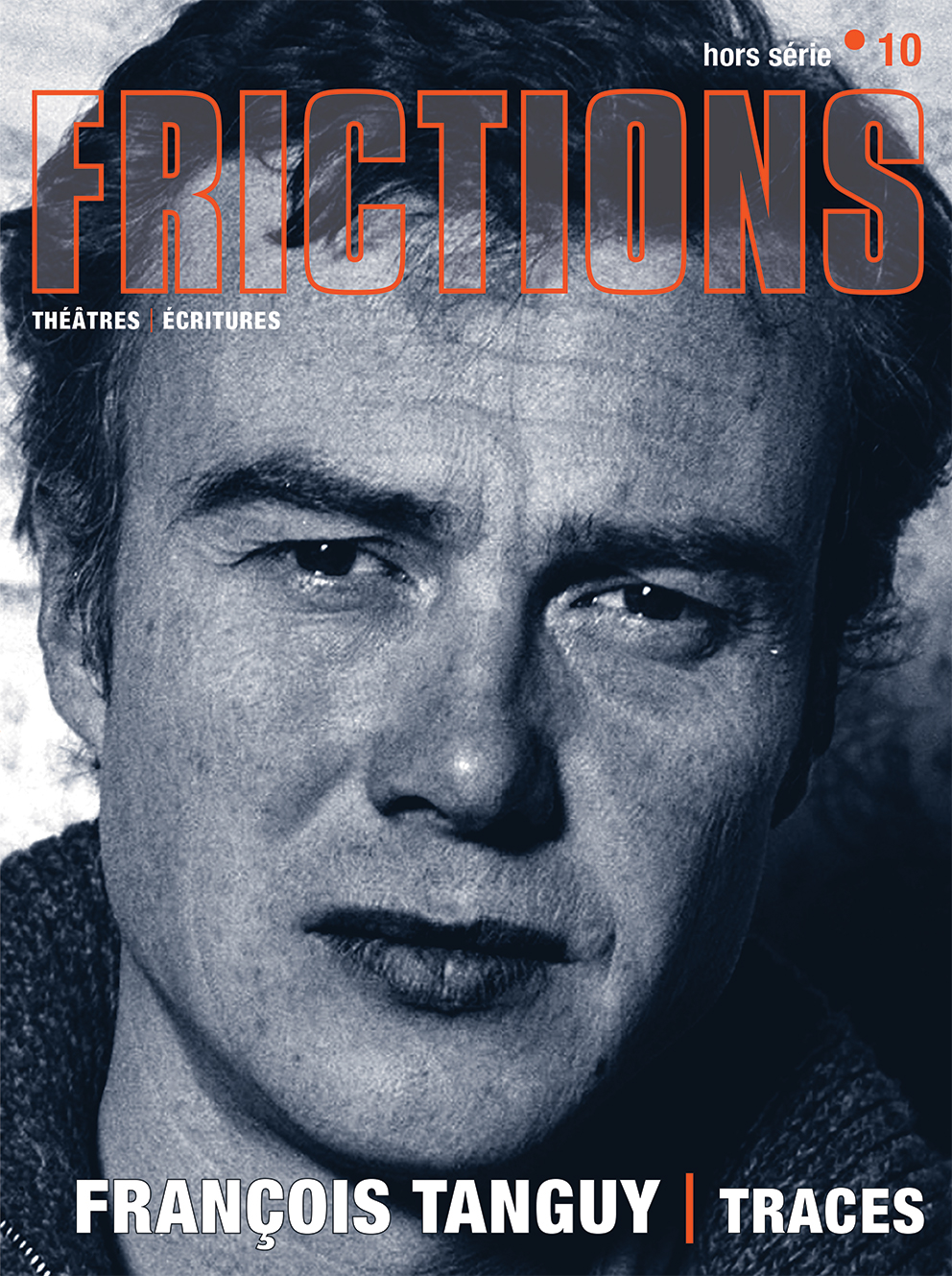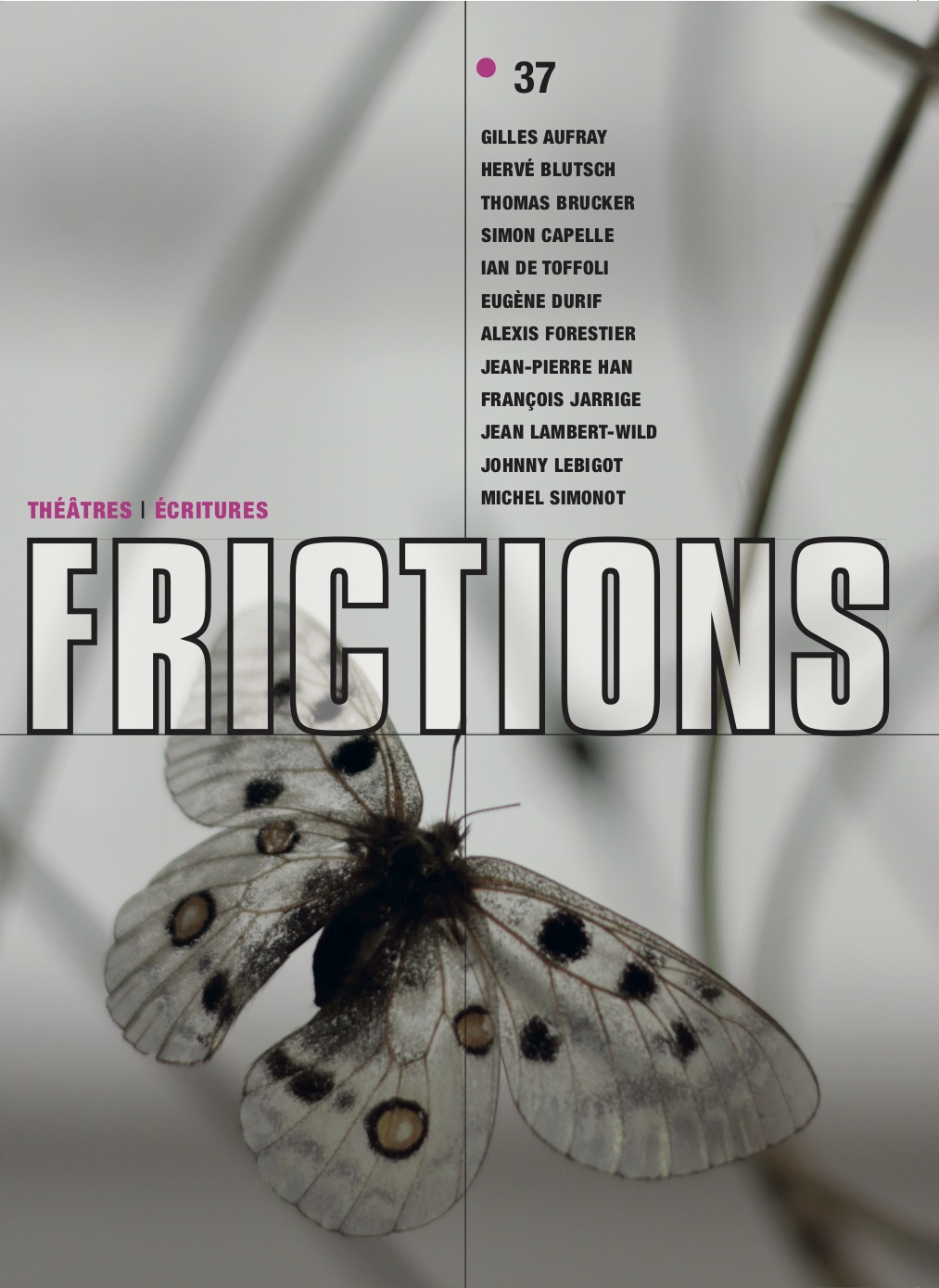Une comédie philosophique et burlesque
Orchestre Titanic, de Hristo Boytchev, mise en scène de Philippe Lanton. Théâtre de l’Aquarium à Paris, jusqu'au 5 février 2017. Tél. : 01 43 74 99 61.
Une gare abandonnée : quatre laissés pour compte, l'un d'eux fait les cent pas dans la salle des pas perdus. Lumière éblouissante, deux tentes, une poubelle géante, sol jonché de partitions déchirées ; symptômes d’une harmonie perdue ? Orchestre Titanic du bulgare Hristo Boytchev, remplit d’emblée la promesse de l’affiche : « Comédie philosophique et burlesque »… Comédie : le jeu, très théâtralisé, souvent présenté face au public qu'il interpelle, concilie les origines de la farce et quelques souvenirs de cinéma burlesque, en particulier à travers une image rappelant quasi littéralement un sketch des Marx Brothers. Philosophique : quatre paumés, quatre errants pourrait-on dire, attendent un train – qui ne s’arrête jamais. Métaphore de l’existence qui nous rappelle le théâtre d’après-guerre de Ionesco ou de Beckett ? Le programme explicite d’ailleurs ce lien à Beckett que l'on pourrait rater ! Il n'est pas jusqu'à la réplique finale : « J'attends », qui ne nous renvoie à l'auteur d'En attendant Godot… Pièce politique ? Orchestre Titanic joue ici la carte de la poésie : récit métaphorique de l’intégration de la Bulgarie à l’Europe, de l’histoire douloureuse des Balkans dans leur position délicate entre Orient et Occident. La référence, cependant, se garde d’être trop précise, évitant la vulgarité d’un réalisme littéral. Et choisit plutôt la métaphore. La pièce égrène ainsi quelques formulations frappantes, comme : « en prison, la plus grande université du monde », ou « le seul salut, c’est l’illusion », ou encore « rien n’existe, pas même la mort. » Les comédiens (Bernard Bloch, Olivier Cruveiller, Philippe Dormoy, Christian Pageault, Évelyne Pelletier), une bande de joyeux lurons réunis autour de Philippe Lanton, généreux et fidèles, talentueux, savoureux, réalisent avec grâce et justesse cette fable poético-politique. Oui. Mais. Tant d’emballage n’emballe pas. La multiplication des références, Beckett, Ionesco, Shakespeare, le cinéma burlesque, les Marx Brothers et même Calderon, alourdit l'ensemble. Le baroque est aussi au rendez-vous de l’absurde, accrochant Brecht au passage. On saute d’un siècle, d’un auteur à l’autre. Tout cela se concilie mal avec la légèreté de l’écriture, qui refuse de fixer un sens, quel qu’il soit. Malgré la mise en scène fidèle à la vivacité du texte, toute en finesse, on regrette cette hésitation permanente entre le réel et l’illusion, entre la réflexion et le divertissement : on ne suit pas bien cette suspension continue du sens. À force de légèreté, on décroche un peu. Rien ne marque. À force de disparition, d’évanescence, d’illusion, on se demande ce que reflète la pièce. Que l'on ne se pose jamais pour développer quoi que ce soit finit par lasser. On manque d’identification, d’épique, de lyrisme, de tragique, de sens. Et tout fonctionne sur le même rythme. La fin du spectacle nous offre cependant un moment de grâce avec l’un des personnages, celui qui paraissait le plus faible, le plus fragile, qui, une fois que tous les autres ont disparu, se retrouve seul, dans un cadre, en fond de scène. Ce qui nous touche, cette fois, c’est le contraire de tout ce que la pièce a mis en avant précédemment : une crédulité, une naïveté, une foi inébranlable en l’avenir. Ce qui nous touche chez ce personnage, qui pour le coup apparaît joliment poétique, c’est son incapacité, justement, à disparaître, lui. Il reste là, à nous sourire. L’écriture ne cherche plus à nous faire comprendre rien d’autre que ce sourire, à ce moment-là. Le personnage sourit de toute sa foi, et la grâce opère.
Julie Grimoud