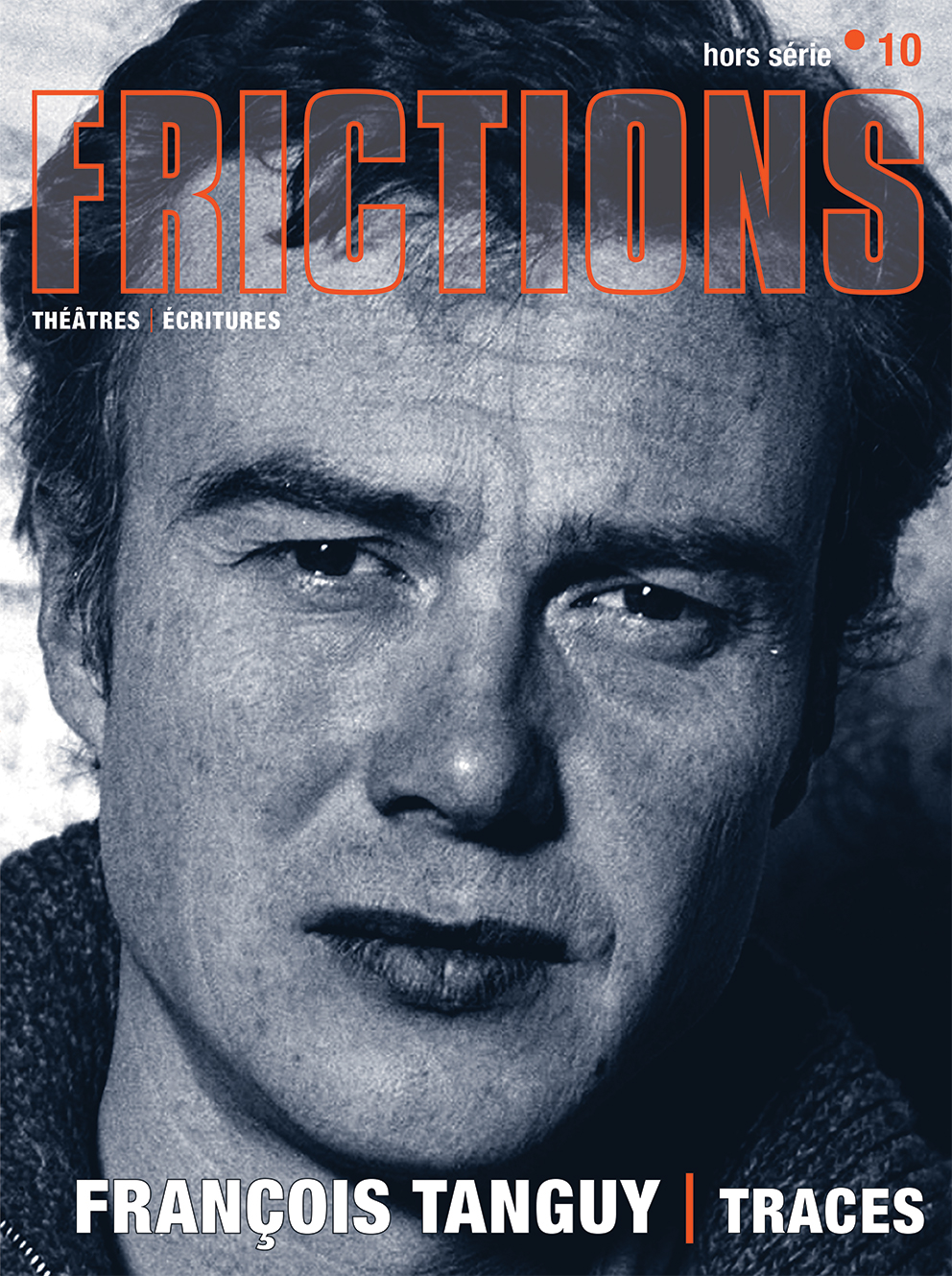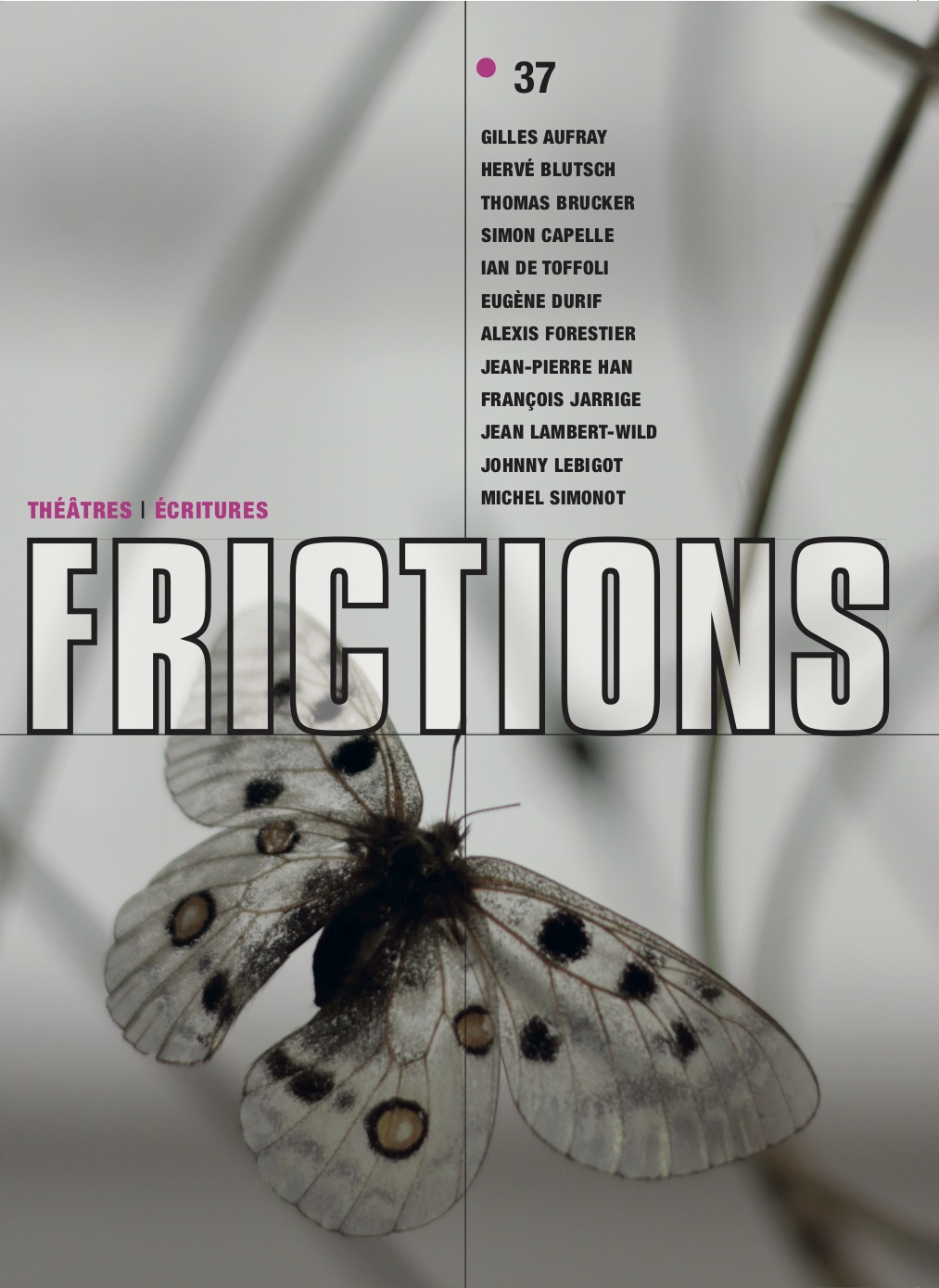Un théâtre de connivence
Catherine et Christian (fin de partie) par le collectif In Vitro. Mise en scène de Julie Deliquet. Festival d'automne. Théâtre Gérard-Philipe jusqu'au 16 octobre, puis tournée à Villejuif, Marne-la-Vallée, Choisy-le-Roi. Tél. : 01 48 13 70 00.
À la fin des années 1990 – c'était au siècle dernier –, sans qu'il y ait eu la moindre concertation, théoriciens et praticiens de théâtre se (re)posèrent la question de savoir à quoi pouvait bien servir le théâtre. Quatre ou cinq ouvrages vinrent étayer ce questionnement. Le théâtre est-il nécessaire ? se demanda Denis Guénoun. À quoi sert le théâtre ? insista Sylviane Dupuis. Plus pragmatique, le journaliste Jean-Pierre Thibaudat (il officiait à l'époque à Libération) recueillit un certain nombre de textes de metteurs en scène accompagnés d'Alain Badiou sous le titre de Où va le théâtre ? Plus d'une décennie plus tard une réponse cinglante nous vient d'un plateau occupé par une jeune équipe, un collectif bien évidemment – c'est dans l'air du temps – tout de même dirigé par son metteur en scène, Julie Deviquet. « À rien ! » (on évitera d'entrer dans le débat de la dépense improductive selon Georges Bataille !). C'est très exactement ce que nous donne à entendre son dernier spectacle, Catherine et Christian (fin de partie), un additif au triptyque qu'elle avait présenté l'année dernière sous la même égide du Festival d'automne dont on pourra toujours louer l'obstination à accompagner une compagnie émergente, autre appellation très prisée par la ministre de la Culture et les médias. J'avais, à l'époque, émis les plus grandes réserves concernant le triptyque qui réunissait La Noce de Brecht, Derniers remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce ainsi qu'une création collective, Nous sommes seuls maintenant. Nous y revoilà donc, sans auteur reconnu (ce qui évitera aux dits auteurs d'être massacrés), sans texte a-t-on envie d'ajouter, car ce qui est émis sur le plateau – ce quotidien le plus quotidien, les petites choses de la vie – est sans doute l'émanation d'improvisations ; quant à une quelconque écriture après coup… J'avais également parlé à propos de pratiquement tous les spectacles des équipes émergentes de « syndrome de la table ». Nous sommes servis cette fois-ci, si je puis dire, puisque nous sommes conviés dans une salle de restaurant emplie de nombre de petites tables, six en tout que l'on peut bien sûr rassembler pour former une fameuse grande table… Mais passons sur la désignation d'un lieu précis, et revenons au propos du collectif In Vitro. Habiles dans leur discours hors plateau – c'est une autre caractéristique de ces jeunes équipes – In Vitro poursuit, dit-il, et achève son cycle générationnel entamé avec la Noce de Brecht décalé aux années 1950, pour en arriver à aujourd'hui, en faisant donc table rase du passé et sans doute enfin vivre le présent, voire tourner son regard vers l'avenir (dans un prochain spectacle ?). Une « fin de partie » donc qui n'a cependant rien de beckettienne. Tout cela est fort bon, mais qu'avons-nous sur le plateau ? Des petites histoires de famille (pas de n'importe quel milieu quand même) juste après l'enterrement de la mère. Retrouvailles et chamailleries avec évocation des jours anciens plus ou moins heureux. Pas de quoi fouetter un chat ! Comme Julie Deliquet et ses camarades n'en sont désormais plus à leurs balbutiements (encore que), l'affaire est relativement bien ficelée. Rien de scandaleux dans leur travail bien sûr, même si celui-ci relève du savoir-faire, rien que du savoir-faire. Pour le reste… Ces historiettes sans intérêt (il y en a plusieurs enchâssées les unes dans les autres) finissent par nous laisser de marbre. On a beau se creuser la tête et se demander quel est l'enjeu d'un tel déploiement, rien n'y fait. Au fil de la représentation l'ennui gagne, ce qui se passe sur le plateau, dans une éternelle répétition du propos et du jeu lassent par leur convenu absolu. Les acteurs, ils sont onze sur le plateau, évoluent plutôt bien dans ce convenu ; quel autre registre pourraient-ils, ont-ils envie d'explorer ? Ils tournent donc en rond dans leur petit registre.
On me dira que la comparaison est écrasante et qu'elle n'aurait pas lieu d'être, mais difficile de ne pas évoquer ici le récent chef d'œuvre de Krystian Lupa avec Des arbres à abattre d'après Thomas Bernhard. Ce spectacle réunit aussi une famille, « intellectuelle » celle-là, pour un dîner après l'enterrement d'une amie commune, une comédienne qui s'est suicidée et que l'on a pu voir en vidéo en début de spectacle. Le narrateur qui a eu la faiblesse d'accepter l'invitation est là, présent sur scène. On a donc un authentique point de vue sur le déroulement de la soirée. Ce narrateur, c'est Thomas Bernhard lui-même, le grand écrivain que l'on sait, en parfaite osmose avec le metteur en scène Kristyan Lupa que l'on ne présente plus. Quant aux comédiens ils sont étourdissants, sachant jouer de tous les registres, eux… Un texte d'une force et d'une férocité incroyables mis en valeur par un metteur en scène et des acteurs au talent époustouflants, en somme tout ce qui manque à Catherine et Christian (fin de partie)…
Jean-Pierre Han