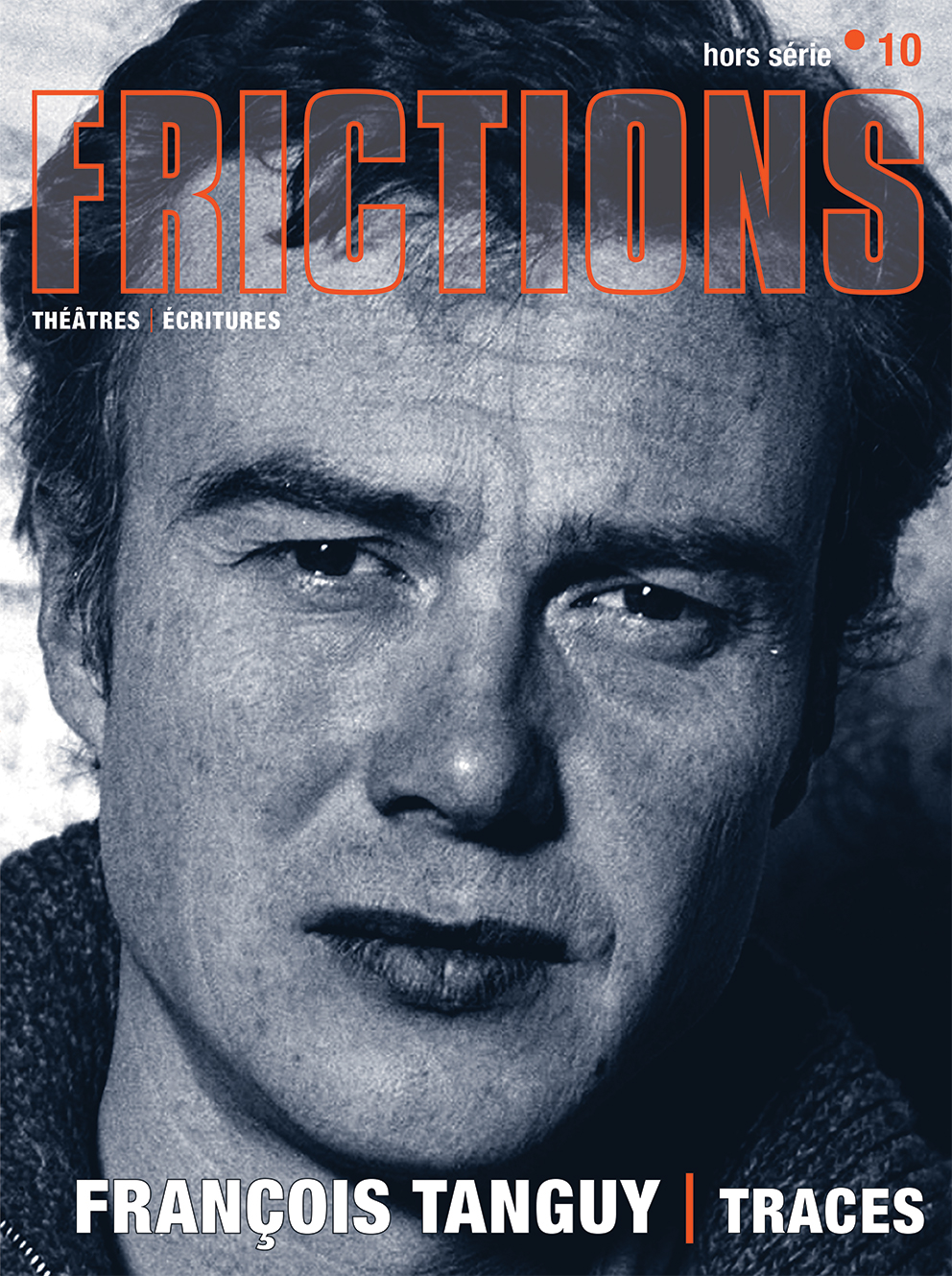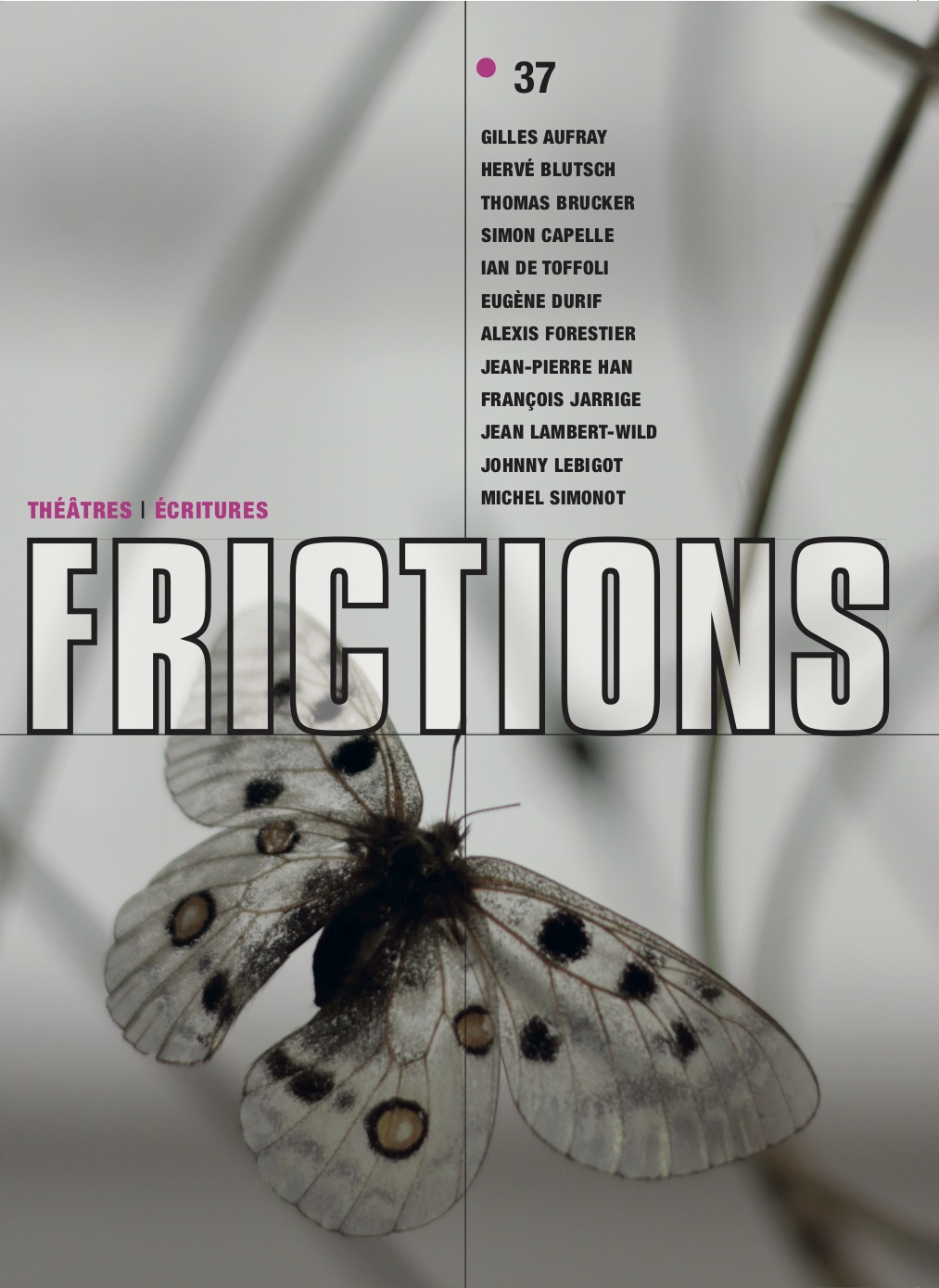L'insidueux travail de la mort
La Bête dans la jungle d'après Henry James, adaptation de Marguerite Duras suivi de La Maladie de la mort de Marguerite Duras. Mise en scène de Célie Pauthe. Théâtre national de la Colline. Jusqu'au 22 mars à 20 h 30. Tél. : 01 44 62 52 52.
C'est peu de dire que l'œuvre d'Henry James, et tout particulièrement La Bête dans la jungle, a hanté son « adaptatrice » Marguerite Duras. À telle enseigne qu'elle y est revenue à plusieurs reprises, en 1962 et en 1981, songeant même à une adaptation cinématographique du texte qui ne se réalisa pas. Ce qui est sûr c'est que La Bête dans la jungle est « de toutes les adaptations de Duras, non seulement la plus importante, mais celle qui dialogue le plus intimement avec le reste de sa production » comme le souligne à juste titre Gilles Philippe qui a dirigé l'édition des œuvres complètes de Marguerite Duras dans la Pléiade. Dialogue, le mot semble même faible : sur le plateau du théâtre de la Colline, le spectateur peut se demander s'il n'est pas devant une œuvre de Marguerite Duras, tant certaines situations et certaines répliques renvoient aux thématiques et aux formulations de sa propre œuvre. Célie Pauthe qui a mis en scène le spectacle, et s'autorisant sans doute de ce qu'avait pu dire Maurice Blanchot, appuie encore le trait puisqu'elle joint à l'adaptation de la nouvelle de James le texte de Marguerite Duras, La Maladie de la mort, redistribuant les rôles des deux protagonistes de la Bête dans la jungle autour du nouveau personnage central interprété avec finesse par Mélodie Richard. Elle le fait dans une seule et même continuité, en ne changeant que quelques éléments de la scénographie, comme pour bien affirmer que la maladie de la mort parcourait déjà souterrainement la Bête dans la jungle. Belle intuition sans doute qui ne trouve cependant pas forcément sa matérialisation sur le plateau, l'écriture de La Maladie de la mort différant malgré tout de celle réalisée à partir du texte d'Henry James via la traduction de James Lord. On le regrette d'autant plus que la mise en scène du premier texte nous happe littéralement, dans la grandiose et superbe scénographie de Marie La Rocca (également créatrice des costumes) éclairée par les lumières de Sébastien Michaud : soit les salons « en enfilade » d'un château laissant l'espace central (et mental) pratiquement vide… comme indiqué dans les didascalies de Marguerite Duras que Célie Pauthe et Marie La Rocca respectent à la lettre. Cet espace avec les amorces d'autres salons va être le lieu où les deux protagonistes, Valérie Dréville et John Arnold, vont apparaître et disparaître comme à la recherche d'une improbable et véritable rencontre, et à la révélation finale de l'homme qui comprendra enfin devant la tombe de la femme ce qu'était son pressentiment d'un événement singulier devant marquer sa vie à tout jamais, comme une bête tapie dans la jungle… Histoire d'une passion manquée ? On pourrait presque, si les deux comédiens œuvraient dans le même registre de jeu songer à l'Année dernière à Marienbad… sauf que Marguerite Duras n'est pas Alain Robbe-Grillet et que l'interprétation de Valérie Dréville qui trouve ici un véritable point d'orgue dans la retenue, sa manière de distiller ses répliques dans un sorte de chuchotement, avec une grâce inouïe, est offerte en parfait contraste avec le côté plus terre à terre de John Arnold dans son refus de suivre la femme dans son registre quasiment musical. À l'évidence Célie Pauthe est à son affaire dans ce type de travail de dentellière de la langue.
Jean-Pierre Han