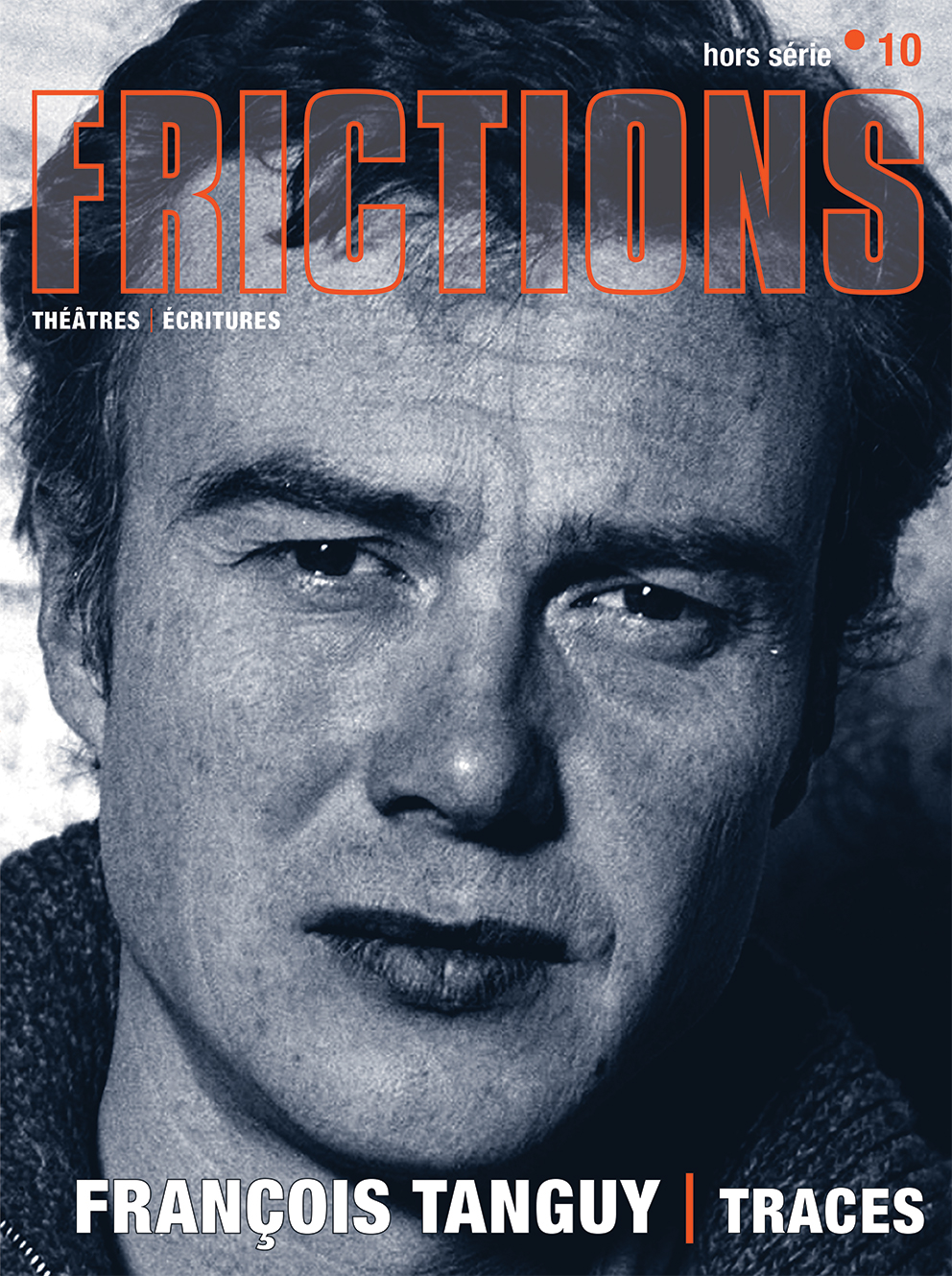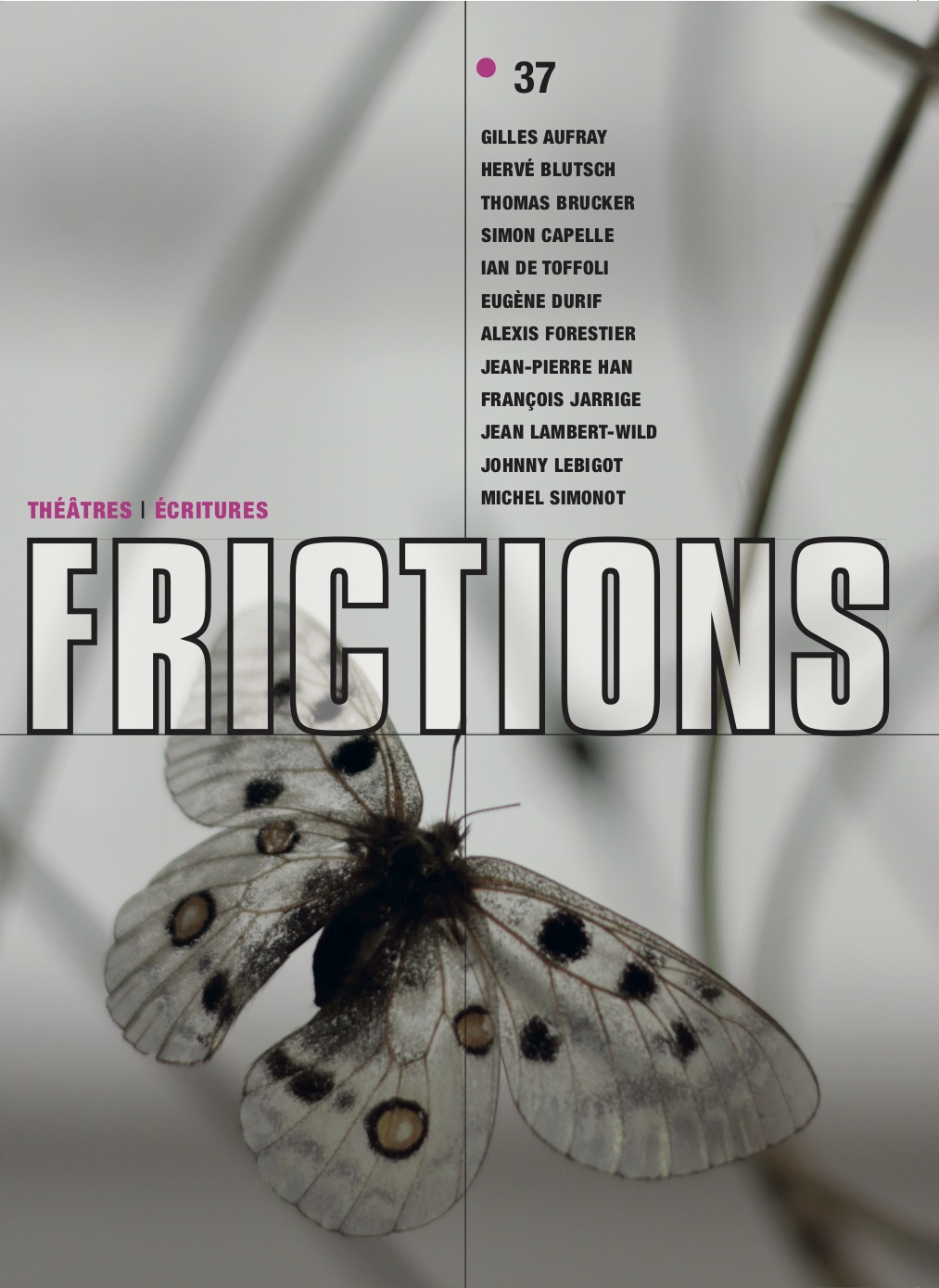Une représentation de haut vol
Le Canard sauvage d'Henrik Ibsen, traduit par Eloi Recoing. Mise en scène de Stéphane Braunschweig. Théâtre national de la Colline, jusqu'au 15 février puis tournée. Tél. 01 44 62 52 52.
C'est peu dire que Stéphane Braunschweig entretient avec Ibsen une relation privilégiée : c'est la cinquième fois qu'il s'attaque à une de ses œuvres. Après Peer Gynt dès 1996, Les Revenants, Brand, Une maison de poupée et Rosmersholm, voici donc Le Canard sauvage qui n'est pas la pièce la moins savamment complexe de son théâtre, et qui recoupe bien des thématiques développées dans les pièces citées, même si dans une lettre à Frederik Hegel, son éditeur, partiellement reproduite dans le dossier de presse, l'auteur norvégien explique qu' « à beaucoup d'égards cette œuvre occupera une place à part dans ma production dramatique »… Que l'on songe tout particulièrement à Brand qui mettait en scène de manière remarquable, grâce notamment à l'interprétation de Philippe Girard, un pasteur forcené entraînant ses proches, fils, épouse et toute sa communauté, dans sa chute à cause d'une soif d'absolu qui n'était rien d'autre qu'une intransigeance doctrinaire, en somme tout comme l'un des personnages principaux du Canard sauvage. Autrement dit un certain Gregers, fils d'un négociant en gros et propriétaire d'usine, Werle, qui le domine de toute son immense image projetée sur un écran géant (belle idée à la ficelle et à la symbolique quand même un peu grosses) dans ses dialogues avec son rejeton torturé et de plus en plus courbé sous le poids de cette image paternelle. Personnage retors parce que faible et complexé, à l'homosexualité refoulée, Gregers entend réparer les injustices qu'il décèle dans le monde, en particulier celle qui a permis à son père d'échapper, pense-t-il, à une condamnation que son associé de l'époque a subie pour avoir vendu des bois appartenant à l'État. Le vieux lieutenant Ekdal a donc fait de la prison et a du même coup perdu la raison. Il vit désormais chez son fils Hjalmar qui a pu devenir photographe grâce à la générosité de Werle, lequel a été encore plus loin en le mariant à une de ses anciennes employées qu'il a eu comme maîtresse. Hjalmar, un pitoyable mythomane facilement manœuvrable, est un camarade d'école de Gregers. Le couple formé par les deux amis est d'autant plus médiocre que les acteurs chargés de les interpréter, Rodolphe Congé (Hjalmar) et Claude Duparfait (Gregers), n'hésitent pas à forcer le trait jusqu'à la caricature, pas tout à fait à tort d'ailleurs, car à certains égards le tragique poussé à son extrême finit toujours par revêtir des accents ironiques et même comiques dérisoires. C'est chose faite ici. En contrepoint à cette triste réalité, unique échappée de l'imaginaire, et parfait recoin de la conscience cher aux psychanalystes, une « forêt » de sapins que Hjalmar et sa femme Gina (interprétée avec une fermeté teintée de subtilité par Chloé Réjon) ont aménagée dans le grenier de leur appartement afin qu'Ekdal puisse élever des poules et des lapins et redevenir, le temps d'une crise, le chasseur chevronné qu'il fut sans doute autrefois. C'est surtout dans ce lieu que Braunschweig qui dirige toujours avec bonheur et pertinence la manœuvre scénographique de tous ses spectacles (avec la collaboration d'Alexandre de Dardel), et qu'il agrandit ici, en fond de scène qui se découvre aux moments voulus, à la dimension d'une véritable forêt, c'est dans ce lieu qu'un canard sauvage qui a réchappé à la mort, survit grâce aux soins attentifs d'Hedvig, la fille du couple Hjalmar-Gina, une adolescente de 14 ans menacée de cécité, une infirmité héréditaire. Extraordinaire et bouleversante Suzanne Aubert, véritable révélation du spectacle. Éléments du drame mis en place, avec des personnages « secondaires » mais néanmoins importants dans l'économie de la pièce (on pense au médecin voisin, Relling, interprété avec une sorte d'ironie désabusée par le remarquable Christophe Brault), machine infernale comme dirait Cocteau remontée à bloc, ne reste plus qu'à la mettre en branle. Un « honneur » qui revient à Gregers, à la recherche de son absolu de vérité et de transparence : il révélera donc à Hjelmar ce qu'il croit être les dessous de la générosité de son père pour l'entraîner vers les sommets d'une certaine spiritualité. On s'en doute, le prix à payer sera cher. En somme, comme il est dit dans le texte, « elle se venge la forêt »… C'est tout cela que la mise en scène de Stéphane Braunschweig parvient à dévoiler (de dévoilement en dévoilement, voilà le leitmotiv de la pièce) avec une belle précision, non sans jouer des fausses perspectives pour déplacer le regard du spectateur, allant même à un moment donné jusqu'à faire incliner le plateau. Ce n'est pas un hasard si la jeune héroïne, Hedvig, est menacée de cécité ; il y a là tout un symbole dans un spectacle où la lumière, réelle et symbolique, joue un rôle de premier plan. Aveuglante clarté… Freud se repaissait des pièces d'Ibsen qu'il cite souvent dans ses écrits : on comprend aisément pourquoi.
Jean-Pierre Han