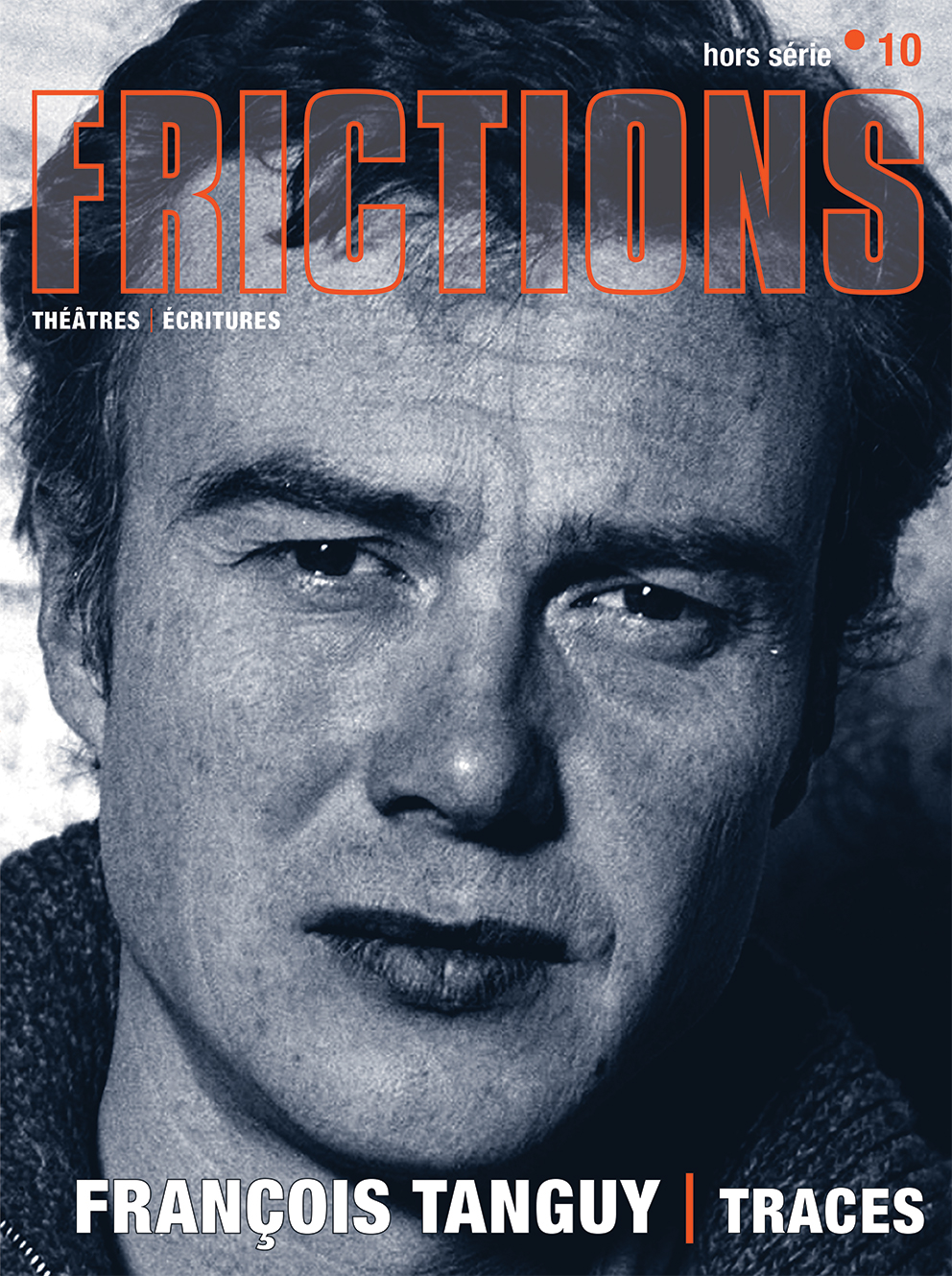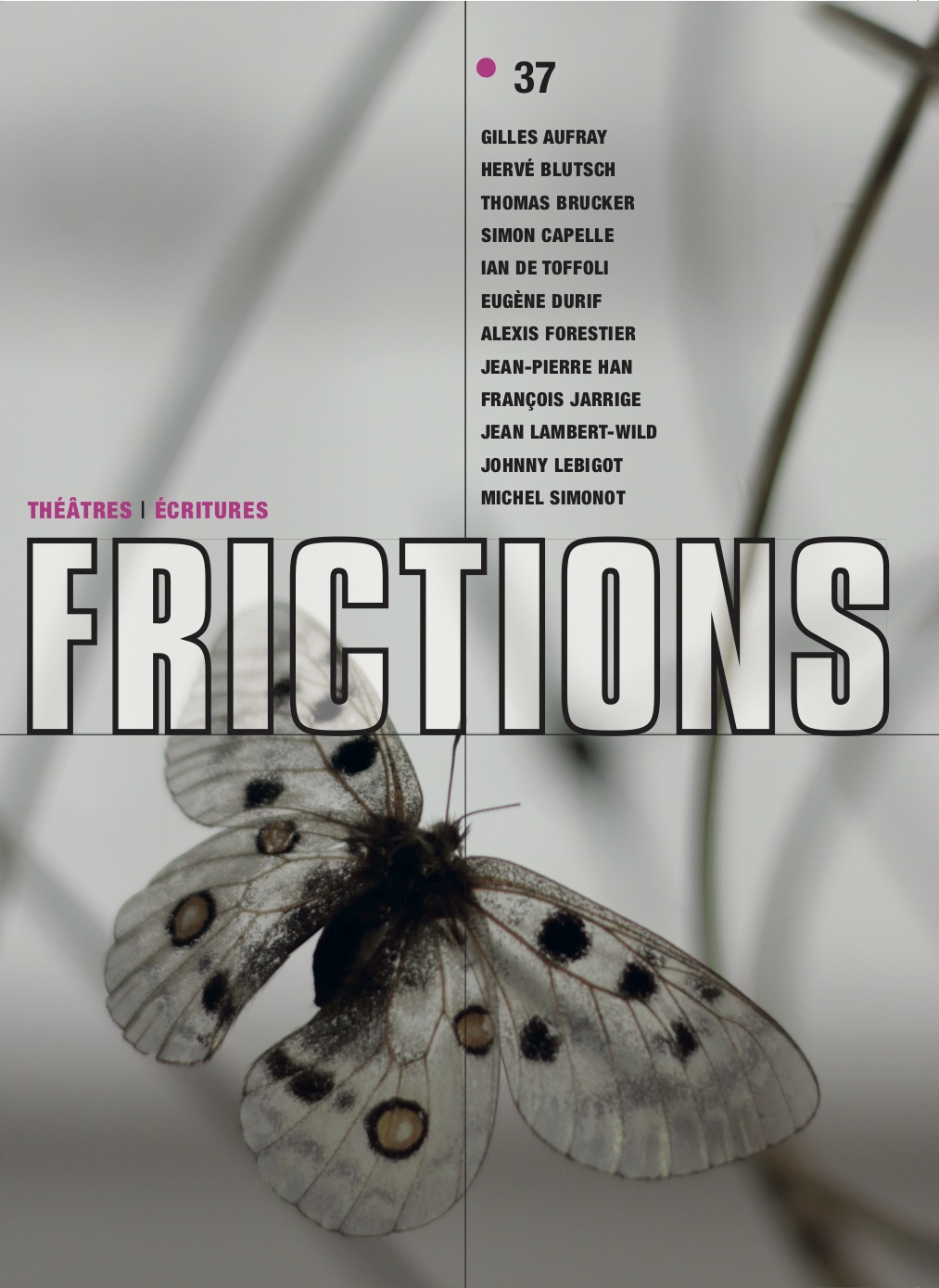Avignon 2013 : l'édition des adieux
Qu'en a-t-il été de la dernière édition du Festival d'Avignon ? Dernière étant bien le terme adéquat pour le duo directorial, Hortense Archambault-Vincent Baudriller, prié longtemps à l'avance par l'ancien gouvernement représenté par l'inénarrable Frédéric Mitterrand de plier bagage pour laisser la place à Olivier Py lui-même chassé du Théâtre de l'Europe-Odéon au profit d'un ami du pouvoir d'alors… Rien que du très banal. Dernière édition donc pour Hortense Archambault et Vincent Baudriller lequel est déjà recasé au théâtre Vidy de Lausanne, avec une floraison de compliments appuyés (notamment par l'actuelle ministre de la Culture, Aurélie Filipetti) après dix ans de « bons » et loyaux services. On pourra toujours s'interroger sur la signification de ces « bons » (services) : est-ce à dire que le festival a parfaitement répondu à ce qui est désormais la nouvelle donne des institutions festivalières dans nos sociétés libérales avancées ? Sans doute, et, cerise sur la gâteau, Archambault et Baudriller ayant également su mener à bien leur projet d'une nouvelle (et magnifique) salle de répétitions et de spectacles aux dimensions de la scène de la Cour d'honneur du Palais des papes, et de lieu de résidence implanté dans un quartier d'Avignon hors remparts, entre les quartiers Monclar et Champfleury culturellement déserts, la FabricA, ont pu l'inaugurer en grandes pompes lors de cette 67e édition du Festival. Concert de louanges donc pour le duo qu'illustre et résume bien le titre d'un article du Monde : « Ils ont remis le théâtre sur le devant de la scène », un compliment appuyé plutôt paradoxal (et peu amène pour ceux qui les ont précédé à la tête du Festival, et notamment pour Bernard Faivre d'Arcier qui fut pour ainsi dire leur « père » dans le métier) si on veut bien considérer que la polémique de l'édition 2005 reposait justement sur le fait que la programmation faisait la part trop belle à des spectacles que certains n'hésitèrent pas à qualifier de non-théâtraux ! Resterait donc à définir ce qu'est, pour les uns et les autres, le théâtre !
Qu'en a-t-il donc été de cette ultime édition avant la prochaine arrivée d'Olivier Py ? L'artiste (le deuxième seulement, après Jean Vilar, à la tête du Festival) était déjà là cette année, mais – ô grinçante ironie – dans le « off », et en « Miss Knife » qui plus est, son double féminin, en fourreau lamé, bas résille et talons aiguilles, au maquillage appuyé de star de la chanson d'un autre temps, à interpréter ses propres textes joliment troussés. Une manière très particulière d'être présent et de prendre ses marques… Qu'en a-t-il été de cette édition ? Il n'est pas forcément aisé de répondre à la question dans la mesure où, pour être tout à fait juste, il faudrait avoir assisté à l'ensemble des manifestations offertes (si on peut dire ; cf. le prix des places), ce qui est matériellement impossible surtout pour cette édition où, pour mettre les petits plats dans les grands, les organisateurs ont fait appel aux artistes qui les ont fidèlement accompagnés lors de leurs dix années de direction, de Thomas Ostermeier (qui fut le premier artiste associé de leur ère) à Christoph Marthaler, en passant par Pippo Delbono, Josef Nadj ou Guy Cassiers, qui firent pour la plupart un seul tour de piste. L'opération s'intitulait d'ailleurs « des artistes un jour au festival ». Difficile dans ces conditions de tous les saisir au vol. Question de choix aussi, comme dans bon nombre de grands festivals où chacun dessine librement son parcours, en faisant parfois volontairement quelques impasses. Les appréciations peuvent dès lors varier d'un commentateur à l'autre ; il n'en reste pas moins que l'on finit toujours par retrouver, à peu de choses près, quelques lignes de forces communes…
Parler du monde En dix années d'existence, Hortense Archambault et Vincent Baudriller n'ont pas dérogé d'un iota de leur règle d'or : parler du monde tel que nous le vivons ici et là, maintenant. La formule, on en conviendra, est assez vague pour autoriser toutes les propositions artistiques quelles qu'elles soient, parfois même en contradiction les unes avec les autres. Elle est également à prendre dans son sens le plus large : parole a été donnée à des dramaturgies venues de pays lointains. Ce n'est pas tout à fait un hasard si l'un des deux artistes associés de cette année était le congolais Dieudonné Niangouna qui se partagea donc les honneurs avec le français Stanislas Nordey, le reste de la programmation comme toujours très internationale faisant la part belle à l'Afrique avec d'autres artistes congolais, Faustin Linyekula et Delavallet Bidiefono, le burkinabé Aristide Tarnagda ou le nigérien Qudus Onikeku, alors que les européens du collectif Rimini Protokoll décidaient de dénoncer le business qui sévit à Lagos, au Niger (Lagos business angels)… À partir de là – on le vit bien avec le vrai-faux théâtre documentaire de Rimini Protokoll, pas vraiment convaincant et en tout cas plutôt ambigu – toutes les formes de captation et de restitution du réel (le monde tel qu'il va mal) sont autorisées, ce qui peut donner d'étranges réalisations, ce qui permet aussi d' « actualiser » les classiques lorsque ceux-ci sont choisis, comme le Faust I + II de Goethe mis en scène par Nicolas Steemann qui, en 8 heures 30 de temps ne parvint pas à nous convaincre totalement. Concernant ce spectacle de l'œuvre intégrale de Goethe, le programme nous prévenait bien : « Plus qu'ambitieux, le projet de mettre en scène le classique par excellence de la littérature allemande semble être condamné à l'échec… ». On ne pouvait mieux dire, et le savoir-faire (qui ne resta que du savoir-faire) de Nicolas Steemann ne nous fit pas changer d'avis malgré quelques beaux moments. Le monde, toujours, avec une autre déception, celle d'Angelica Liddell, tonitruante « découverte » de l'édition 2010 avec La Casa de la fuerza, et qui, cette fois-ci, avec deux spectacles, Ping Pang Qiu et Todo el cielo sobre la tierra entendait clamer son indéfectible amour pour la Chine qu'elle a récemment découverte. Seulement voilà ce qu'elle a à nous dire sur la question dans une dramaturgie approximative ne dépasse guère les quelques clichés qui traînent partout ; reste en revanche, lorsqu'elle laisse carrément tomber ce registre convenu et en revient à l'essentiel, c'est-à-dire à elle-même et à sa rage contre l'univers entier, un extraordinaire numéro de performeuse comme on en voit peu, d'une force qui emporte tout sur son passage, avec une maîtrise peu commune. On la retrouvait là tout entière comme dans son Année de Richard (en référence au Richard III de Shakespeare).
Une « révélation » surfaite « Comment va le monde, môssieu ? » comme disait jadis le dramaturge François Billetdoux. Mal, très mal, semblent dire tous les artistes interpellés lors du Festival. A commencer par celui que quelques critiques ont voulu nous faire passer pour la révélation de l'année (c'est devenu un rite : il faut absolument une « révélation » à chaque édition du Festival : ce fut Angelica Liddell justement en 2010, Vincent Macaigne l'année d'après, etc.), ce fut Julien Gosselin que l'on tenta de désigner :, un tout jeune homme de 26 ans, artiste émergent donc, ce qui convient à la mode du moment, signataire de deux mises en scène seulement avant celle présentée à Avignon : Gênes 01 de Fausto Paravidino, et Tristesse animal noir d'Anja Hilling que Nordey a récemment monté à son tour, pas forcément mieux. Avec son équipe constituée en majeure partie de comédiens rencontrés lors de sa formation à l'Epsad du Nord Pas-de-Calais (une des bonnes écoles de l'Hexagone), il a constitué le groupe – presqu'un collectif – « Si vous pouviez lécher mon cœur »… de quoi affoler toute la population festivalière, d'autant que l'objet choisi pour faire montre de leur talent reposait sur un succès littéraire, Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq. Pourquoi pas ? Mais que l'on ne nous dise pas que le spectacle produit rendait compte de la désillusion de l'après-mai 68 (auquel cas, l'analyse se serait révélée plutôt sommaire, « élémentaire » effectivement), que l'on ne nous dise pas qu'il y a là, tout à coup, la révélation d'un extaordinaire talent théâtral. Rien ne permet de le dire à la vue du spectacle, bien monté, bien joué certes, mais dans des formes largement connues, voire convenues. Quant à ce qui se dégage de l'ensemble, on reste pour le moins sceptique : le monde se réduirait-il à cette caricature (toute houellebecquienne) où l'essentiel de la démarche des personnages concernés consiste à fréquenter les boîtes à partouzes ? On est surtout étonné de voir que la trajectoire (qu'il dit être logique) de Julien Gosselin part du texte éminemment politique de Fausto Paravidino pour passer par le roman de Houellebecq. Comprenne qui pourra. Mais soyons juste, Houellebecq (et ceux qui l'interprètent ?) n'est pas seul à être dans cet état d'esprit (!) : à considérer d'autres spectacles de la programmation du « in » on ne pourra que faire le constat que les mêmes leitmotiv reviennent, ceux d'une réelle désespérance à sinon se réaliser, du moins à simplement vivre ou survivre dans nos sociétés libérales avancées rongées par le cancer du capitalisme. D'où cette dérisoire tentative de libérer à tout prix nos corps (ne parlons pas d'amour) comme dans le Rausch (ivresse) co-réalisé par l'allemand Falk Richter et la chorégraphe néerlandaise Anouk Van Diijk et où les interprètes semblent s'agiter et se heurter comme des insectes contre des parois de verre. C'est encore plus patent dans le spectacle tant attendu du polonais Kryzysztof Warlikowski – un autre grand nom de la scène européenne –, Kabaret Warszawski, où toute la deuxième partie qui dure deux heures sur les quatre de l'ensemble se passe également dans une boîte à partouzes. Nous sommes là au lendemain du 11 septembre 2001 à New York alors que la première partie nous plongeait dans l'entre-deux guerres et la montée du nazisme. De beaux prétextes historiques qui n'occultent en rien la déception – et l'ennui – à la mesure de l'attente que suscitait l'annonce du projet…
Au milieu de ces lourds et longs pensum, au milieu d'autres déceptions comme celle de Jan Lauwers dans Place du marché 76 ou de Faustin Linyekula avec son Drums and digging, le « petit » spectacle Projet Luciole de Nicolas Truong, avec le couple composé de Nicolas Bouchaud et de Judith Henry, est apparu comme un véritable moment de salutaire respiration. Jongler avec humour et légèreté avec les propos des Pasolini, Foucault, Agamben, Rancière ou autres Badiou s'est avéré des plus réjouissant. Au chapitre des autres satisfactions on notera D'après une histoire vraie du chorégraphe Christian Rizzo ou encore le Walden d'après Henry David Thoreau de Jean-François Peyret même si celui-ci semble s'être fait piéger par ses collaborateurs spécialistes en nouvelles technologies…
Les emblèmes du Festival Restaient les gros morceaux, propositions des artistes associés, Dieudonné Niangouna et Stanislas Nordey dans les lieux emblématiques dévolus à leur statut, la Carrière de Boulbon et la Cour d'honneur du Palais des papes. Avec Shéda pour le premier et Par les villages de Peter Handke pour le second. Soit, pour Shéda, quatre heures durant, une sorte de fourre-tout, brassant tous les genres, tous les temps et toutes les formes pour tenter de saisir l'insaisissable, c'est-à-dire l'univers dans son absolue complexité. Plutôt ambitieux, trop sans doute, et à part quelques fulgurances… C'est donc dans la Cour d'honneur du Palais des papes que Stanislas Nordey a développé le long poème dramatique de Peter Handke, Par les villages, composé en 1981. Comme toutes les grandes œuvres Par les villages évolue délibérément aux frontières de son registre artistique et poétique qu'elle ne cesse de vouloir outrepasser et transgresser. Elle fait partie d'une tétralogie dont les autres éléments sont des romans ; on discerne d'ailleurs dans la trame dramaturgique de la pièce des éléments qui renverraient à un ordre romanesque si d'aventure l'écriture et la langue de l'auteur ne venaient y mettre bon ordre pour faire de ce voyage initiatique, de cette quête de sa propre identité, un authentique poème. Dans cette œuvre dramatique Peter Handke laisse de côté ce qui fait le commun des pièces de théâtre traditionnelles. Son développement est ici d'un autre ordre. Pas ou peu de dialogues, et pourtant il n'est question que de cela, du désir et de la volonté du personnage principal, un écrivain qui retourne dans le village de son enfance, d'établir une relation depuis longtemps rompue, si tant est qu'elle ait jamais existé, avec son frère et sa sœur qui, contrairement à lui, n'ont pas fait d'études et évoluent dans des milieux humbles, ceux des ouvriers et des petits employés, une relation qui passerait par des dialogues, mais ceux-ci à peine ébauchés sont entrecoupés de longs monologues dont certains durent plus d'une trentaine de minutes ! Devant cette œuvre monumentale qui traçait des thématiques qui bouleversaient délibérément les formes théâtrales en ne respectant pas les « règles » de bienséance, de compréhension, d'évolution rapide de l'intrigue – rappelons que le premier texte théâtral de Peter Handke avait pour titre Outrage au public – Stanislas Nordey, à son habitude, prend les choses à bras-le-corps en tentant de restituer le texte dans sa littéralité. La question étant de savoir si l'art de la mise en scène est un art de la littéralité… On reste donc dans une sorte d'entre-deux avec de beaux moments assumés tant bien que mal par les comédiens (tous ne digérant pas forcément de la même manière la « méthode » Nordey) : mi-figue, mi-raisin. À l'image même de toute la manifestation.
Jean-Pierre Han