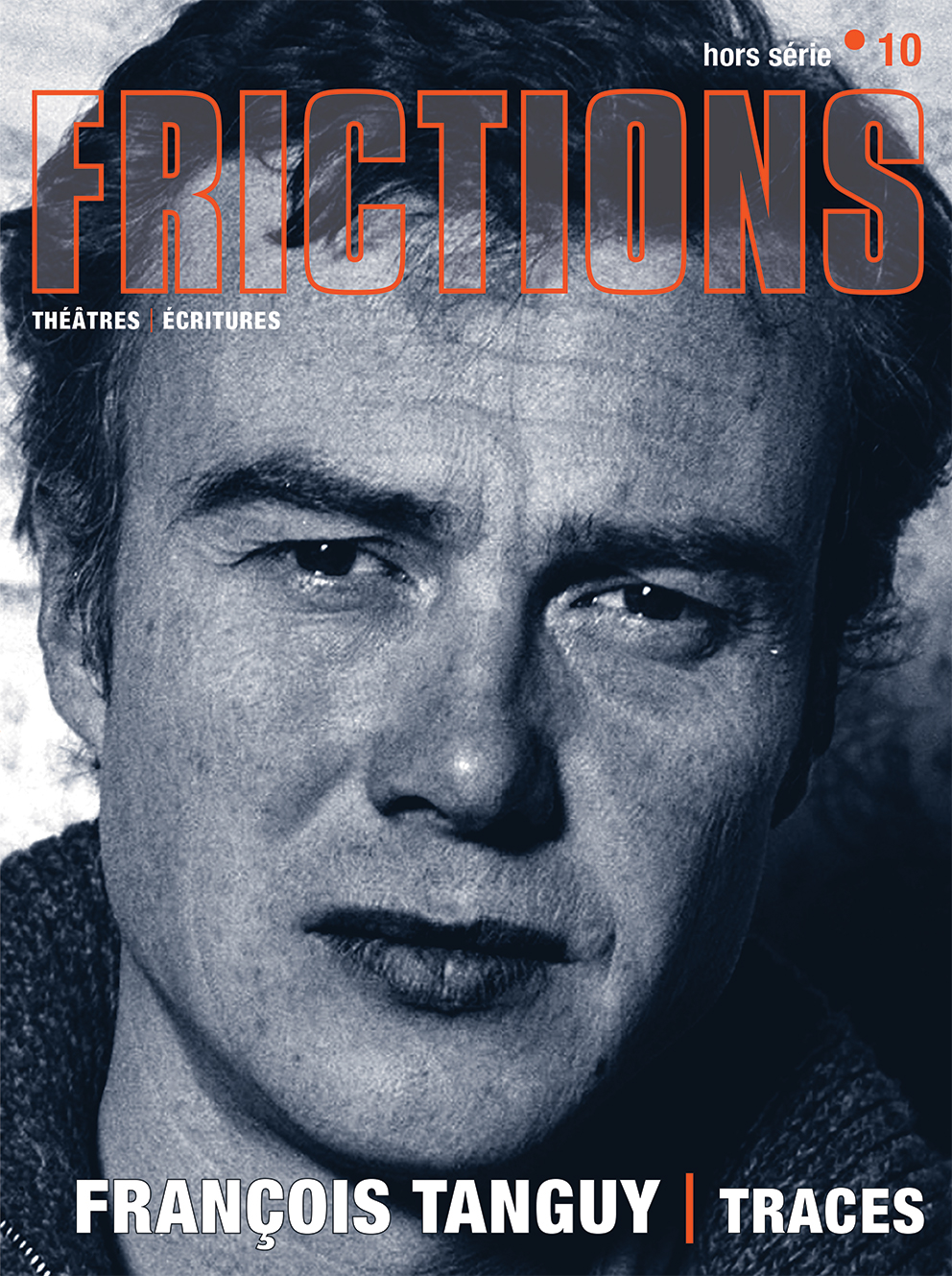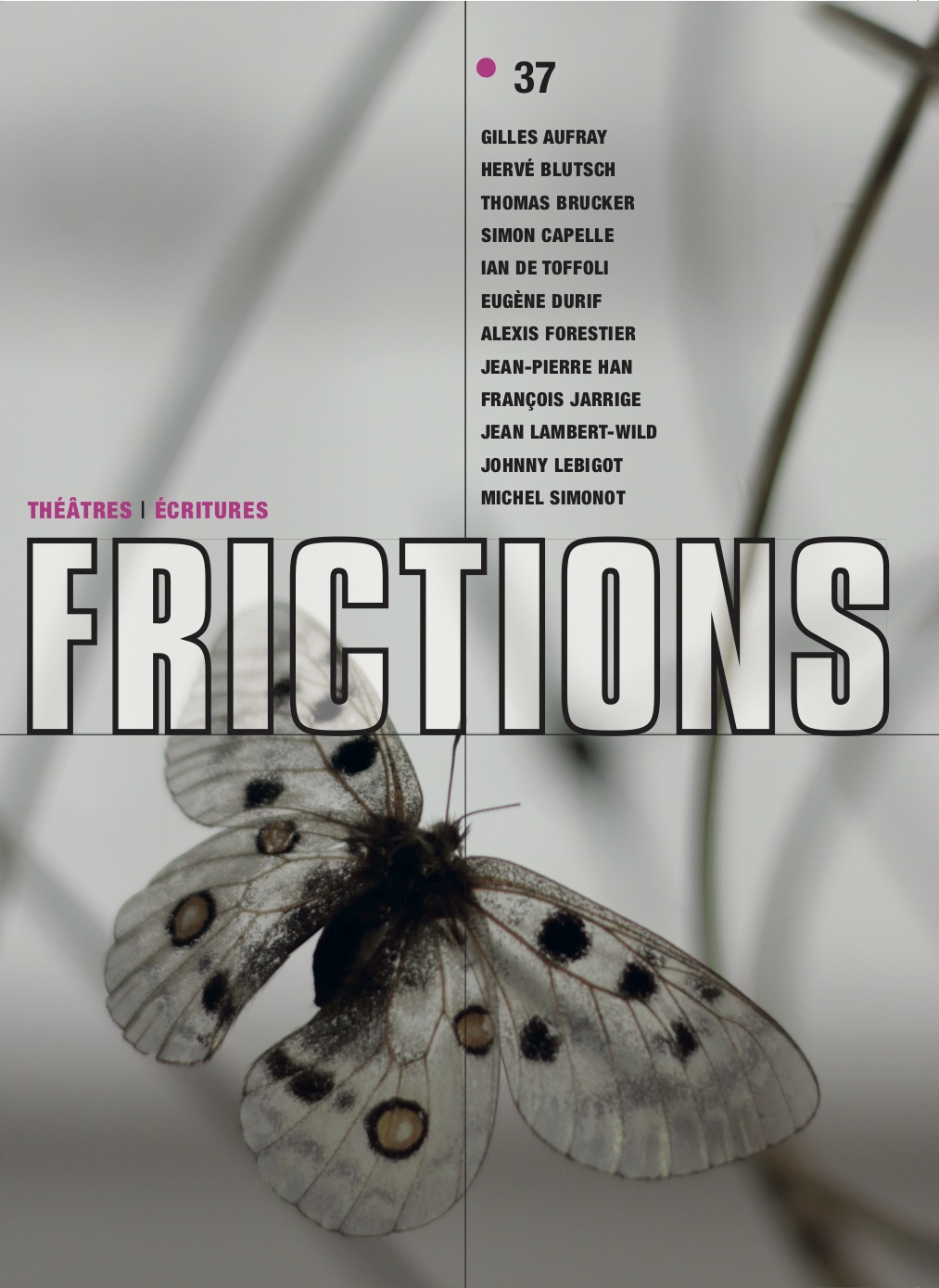Retour raté
Le Retour d'Harold Pinter. Mise en scène de Luc Bondy. Théâtre de l'Odéon. Jusqu'au 23 décembre à 20 heures. Tél. : 01 44 85 40 40.
Lors de la conférence de presse de présentation de la saison du théâtre de l'Odéon il y a quelques mois, le nouveau maître des lieux, Luc Bondy, au moment de parler de sa mise en scène du Retour d'Harold Pinter, prit bien soin de nous préciser que le dramaturge anglais n'avait jamais été vraiment apprécié à sa juste valeur en France, faute sans doute d'avoir été bien traduit et mis en scène. Précision publique plutôt inélégante dans la mesure où le créateur de la pièce dans notre pays est Claude Régy, programmé dans le même théâtre… et que ses travaux non seulement, sur Le Retour, mais également sur L'Amant et La Collection restent sinon dans toutes les mémoires du moins de solides références en la matière. C'était également oublier tout aussi vite que c'est Roger Blin, toujours lui, qui nous fit découvrir le dramaturge anglais avec Le Gardien en 1961, et que ce grand découvreur devant l'éternel (on lui doit, entre autres, les créations d'En attendant Godot de Beckett ou des Paravents de Genet) ne s'est jamais vraiment trompé dans sa manière d'appréhender les pièces qu'il choisissait. Mais bon, nous allions donc (re)découvrir Harold Pinter.
Nous avons donc vu et entendu. Et le moins que l'on puisse dire est que nous sommes loin du compte, notamment justement par rapport à la mise en scène de Claude Régy en 1966. Mais faisons fi du passé : qu'auront donc vu et entendu ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le travail de Claude Régy ? Une étrange histoire d'un clan d'hommes vivant dans le west-end londonien avec le vieux père, boucher à la retraite, prétendant encore régner en maître sur sa maisonnée composée de son frère, le meilleur des chauffeurs de maître, selon ses propres dires bien sûr, et deux de ses fils, l'un boxeur amateur abruti ne rêvant que de gloire sportive, et l'autre, petit maquereau cachant sous des dehors nonchalants toute la perversité du monde. Le retour, c'est celui du fils aîné, docteur en philosophie, enseignant dans une université américaine, marié et père de famille (de trois garçons également) – tous les symboles de la réussite. Il est revenu après un détour par l'Italie pour que sa femme fasse connaissance avec sa famille. Commence alors une sarabande bien dans la manière de Pinter, c'est-à-dire, feutrée, toute en diversions où les moindres paroles, les moindres silences, les moindres gestes ou velléités de gestes sont nimbés de mystère et acquièrent tout à coup une charge lourde de menace. Tout semble pourtant parfaitement clair dans ce décor totalement réaliste. Mais à force de réalisme, à force de banalité, celle des objets comme celle des faits et gestes des uns et des autres (un regard, un soupir), on finit par se retrouver devant une situation quasiment fantasmagorique. C'est hélas précisément cette dimension qui n'existe pas dans la représentation gérée par Luc Bondy. Et plus la pièce avance, plus nous restons à la surface des choses sans qu'aucun mystère ne nous fasse sentir d'étranges et inquiétants arrière-plans. D'esthétique de l'allusion, qui semble bien être l'esthétique de Pinter par excellence, il n'est alors plus guère question au détriment d'un réalisme gênant car hors de propos. Bien évidemment, c'est autour de la femme du fils aîné que tout va se jouer, elle-même entrant de plain-pied dans la danse. On apprendra ainsi qu'elle vivait, elle aussi, dans le west-end où elle exerçait la profession de « mannequin au sens large ; pour le physique. Je posais pour des photographes », selon la nouvelle version de Philippe Djian*, « modèle… pour le corps. Un modèle pour… photographe… du corps » dans la version initiale d'Éric Kahane, ce qui était un peu plus explicite. Impossible peut-être pour elle d'échapper aux relents de cette vie d'autrefois. En toute conscience et devant son mari, déjà absent ou mort, elle se laissera aller dans les bras des deux autres fils, finissant par accepter leur marché consistant à se prostituer pour et avec eux, mais parvenant néanmoins à établir une sorte de contrat lui accordant, dans une sorte de retournement de situation qu'elle exploitera peut-être par la suite, un certain nombre d'avantages. Il ne restera au fils aîné qu'à s'en retourner aux États-Unis…
Le théâtre, c'est ce qui fait son charme, n'est pas un art exact. Luc Bondy l'expérimente à son détriment avec sa mise en scène. Pour nous aider à percer le mystère de la pièce de Pinter, il a réuni une distribution de toute première valeur. Le plateau réuni à l'Odéon vaut son pesant d'or. Avec tout en haut de l'affiche le très grand comédien qu'est Bruno Ganz, dans le rôle du patriarche, un rôle que l'on aurait pu croire taillé à sa mesure ou à sa démesure. Mais justement de démesure il n'est cette fois-ci pas question, Bruno Ganz reste sagement appliqué, et c'est même lui – ô paradoxe – qui ralentit le rythme de la représentation. Les autres interprètes de la famille se sont tous composés des silhouettes inouïes, tel Pascal Greggory dans le rôle du frère. Louis Garrel (l'apprenti boxeur) et surtout Micha Lescot (le maquereau) tiennent leur partition à la perfection, tout comme Jérôme Kircher franchement étonnant dans l'effacement et la veulerie. Le problème c'est que tous ces comédiens ne jouent pas ensemble. À chacun sa silhouette, à chacun sa partition. Il est vrai qu'ils ne sont pas aidés par le personnage pivot de la pièce, Ruth, réceptacle de tous leurs désirs avoués et inavoués, conscients et inconscients. Emmanuelle Seigner, n'est ici qu'une (belle) image plate.
Jean-Pierre Han
- Gallimard éd., 2012.