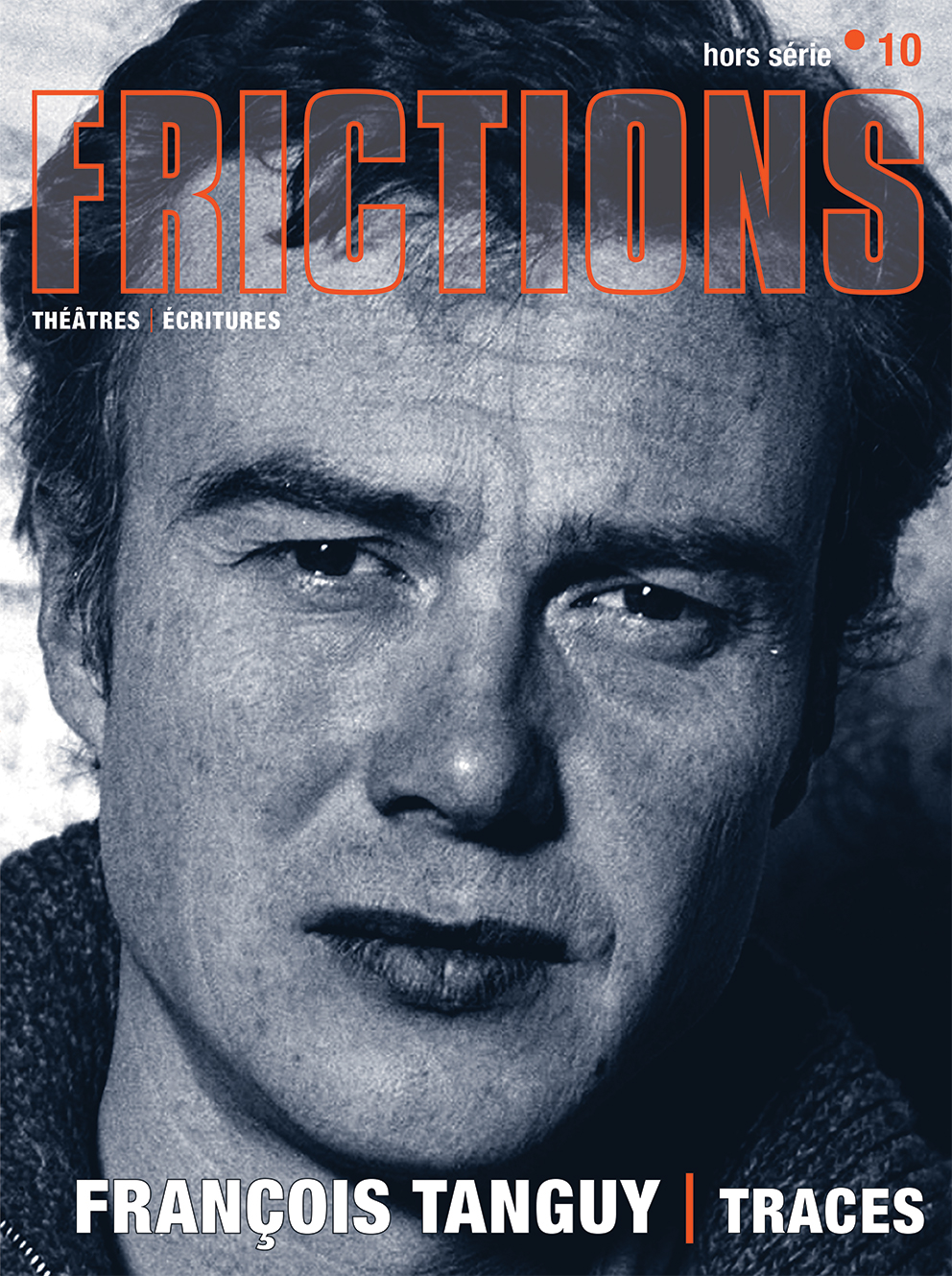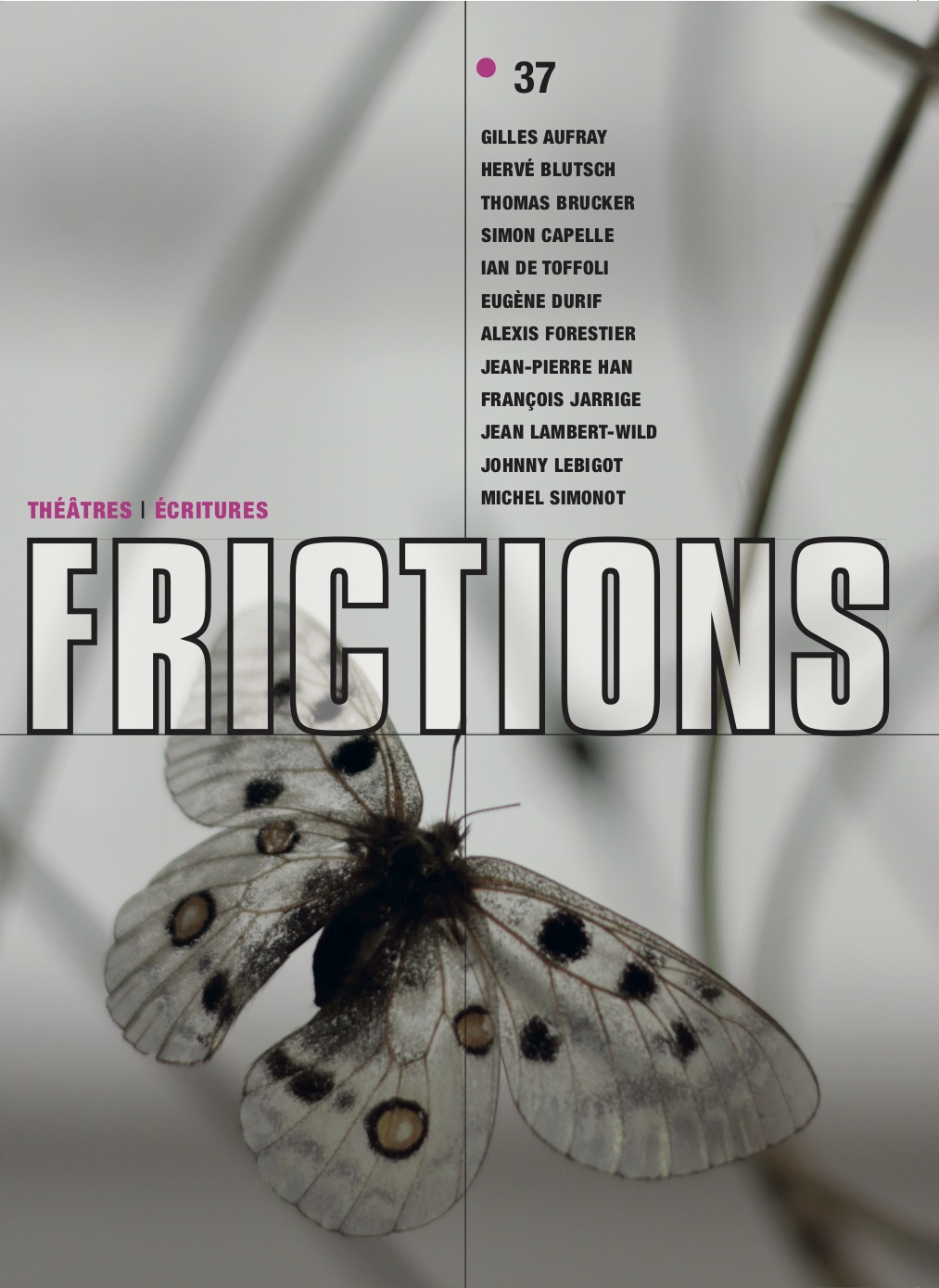Marthaler, enfin ! (pour mémoire)
Dans le cadre du Festival d'automne
Il aura fallu attendre la mise en scène de la pièce du dramaturge de langue allemande Ödon von Horvath, Glaube Liebe Hoffnung (Foi, amour, espérance), par Christoph Marthaler, pour que la saison théâtrale commence véritablement. Enfin, est-on tenté d'ajouter, tant les spectacles présentés jusqu'alors avaient été dans leur grande majorité peu convaincants, sinon totalement ratés ou vains comme l'autre représentation du Théâtre de l'Odéon passé sous la direction de Luc Bondy marquant donc son territoire avec Die schönen Tage von Aranjuez de Peter Handke qui avait été écrit en français, mais qui fut donné ici en allemand. Entre la salle de l'Odéon et celle des Ateliers Berthier (qui fonctionne sous l'égide du Théâtre de l'Odéon) où se donne Glaube Liebe Hoffnung, c'est pour ainsi dire le grand écart.
Christoph Marthaler dont la gamme artistique, où la musique occupe une place prépondérante, semble infinie et joue de toutes les variations – il passe toujours avec la même élégante aisance d'un registre à l'autre – entretient avec Horvath une relation privilégiée : c'est la quatrième fois qu'il entreprend de mettre en scène un de ses textes. Cela tombe plutôt bien dans le cas présent puisque Glaube Liebe Hoffnung fut composé en 1932 juste après Casimir et Caroline que le metteur en scène a monté en 1996. Ces deux pièces devaient à l'origine être réunies sous le sous-titre on ne peut plus clair de « deux petits drames tirés de la vie du peuple ». La vie du peuple décrite par Horvath, voilà précisément ce que ne pouvait supporter Hitler et ses acolytes arrivés au pouvoir en janvier 1933. Les livres d'Horvath furent jetés au feu au sens propre du terme, la mise en scène de Glaube Liebe Hoffnung, prévue la même année, annulée comme nombre d'autres projets le concernant ; Horvath poursuivi par les nazis quittera l'Allemagne pour Vienne où la pièce sera créée en 1936, puis rentrera à Budapest… Le vie du petit peuple : en 1932 il y a près de 6,5 millions de chômeurs en Allemagne. Horvath pour écrire sa pièce s'appuie sur un fait divers que lui a rapporté une de ses connaissances, le chroniqueur judiciaire Lukas Kristl à qui il dédie la pièce. Une jeune fille se présente au Laboratoire d'Anatomie pour vendre son corps ; elle a besoin de 150 marks pour acheter sa carte de représentante en soutiens-gorge. Tel est le point de départ de cette histoire, de cette « petite danse de mort en cinq tableaux », comme le précise l'auteur, qui aboutira au suicide de la jeune fille qui sera sauvée, mais mourra tout de même d'épuisement, de n'avoir rien « bouffé » depuis quelque temps. Le suicide s'avère être un meurtre collectif, celui perpétré par la bêtise et l'esprit petit-bourgeois dont la pièce donne un bel échantillon. D'une fidélité absolue à la pièce d'Horvath, même s'il a rajouté des textes provenant d'autres œuvres de l'auteur, Christoph Marthaler prend au pied de la lettre l'indication de « petite danse de mort » en quelques tableaux. C'est bien de cela dont il s'agit alors qu'à l'avant-scène, un chef d'orchestre dirige de manière hystérique, caricature de dictateur avant l'heure, un orchestre composé d'une multitude de haut-parleurs de toutes tailles et de tous genres qui émettront raclements, bruitages divers et variés, et même quelques notes de musique tout au long du spectacle. Le même chef d'orchestre, au piano cette fois-ci, jouera La Marche funèbre de Chopin comme le souhaitait l'auteur, annonçant ou accompagnant quelques séquences de la pièce. Il faut avoir la subtile intelligence de Marthaler pour rendre compte comme il le fait du texte de Horvath, de la trajectoire tragique tracée d'avance de son « héroïne », Elisabeth, jouet d'une mécanique implacable décrite ici avec une élégance, une douceur incisive entrecoupée, comme toujours chez lui, de chants choraux qui rendent l'histoire à la fois plus douloureuse et plus supportable. Le regard de Marthaler est d'une lucidité impitoyable, mais il est toujours empreint d'une certaine ironie. La « danse de mort » de son héroïne, ici dédoublée (elles sont deux à supporter ainsi le poids du tragique, se passant, se repassant le fardeau de la vie, et celui des changements de décor dont elles ont, seules, à vue, la charge), et comme reflétée à l'infini dans un jeu de miroir, produit une étrange effet sur le spectateur. Marthaler, à son habitude, multiplie les répétitions, les brisures de texte et autres réjouissantes trouvailles scéniques au cœur d'une scénographie dessinée au cordeau par la fidèle Anna Vibrock. De l'ensemble se dégage une sorte de douceur, de plénitude qui rendent encore plus terrifiant le propos de Horvath, propos qui résonnent d'une manière incroyable pour le spectateur d'aujourd'hui. « J'ai tenté d'aller sans égards contre la bêtise et le mensonge » disait Horvath qui apostrophait un peu plus loin son lecteur ou son spectateur en lui disant : « Reconnais-toi toi-même ! » Le spectateur d'aujourd'hui a pu se reconnaître dans cette représentation de Glaube Liebe Hoffnung, par la grâce de Marthaler et de sa formidable équipe qui ont bien compris la recommandation de l'auteur qui stipulait qu' « il faut bien entendu jouer s[m]es pièces de manière stylisée, le naturalisme et le réalisme les tuent. Ils en feraient des tableaux de genre, et non pas des tableaux qui montrent la lutte du conscient avec le subconscient ».
Jean-Pierre Han
article paru dans Les Lettres françaises du 4 octobre 2012