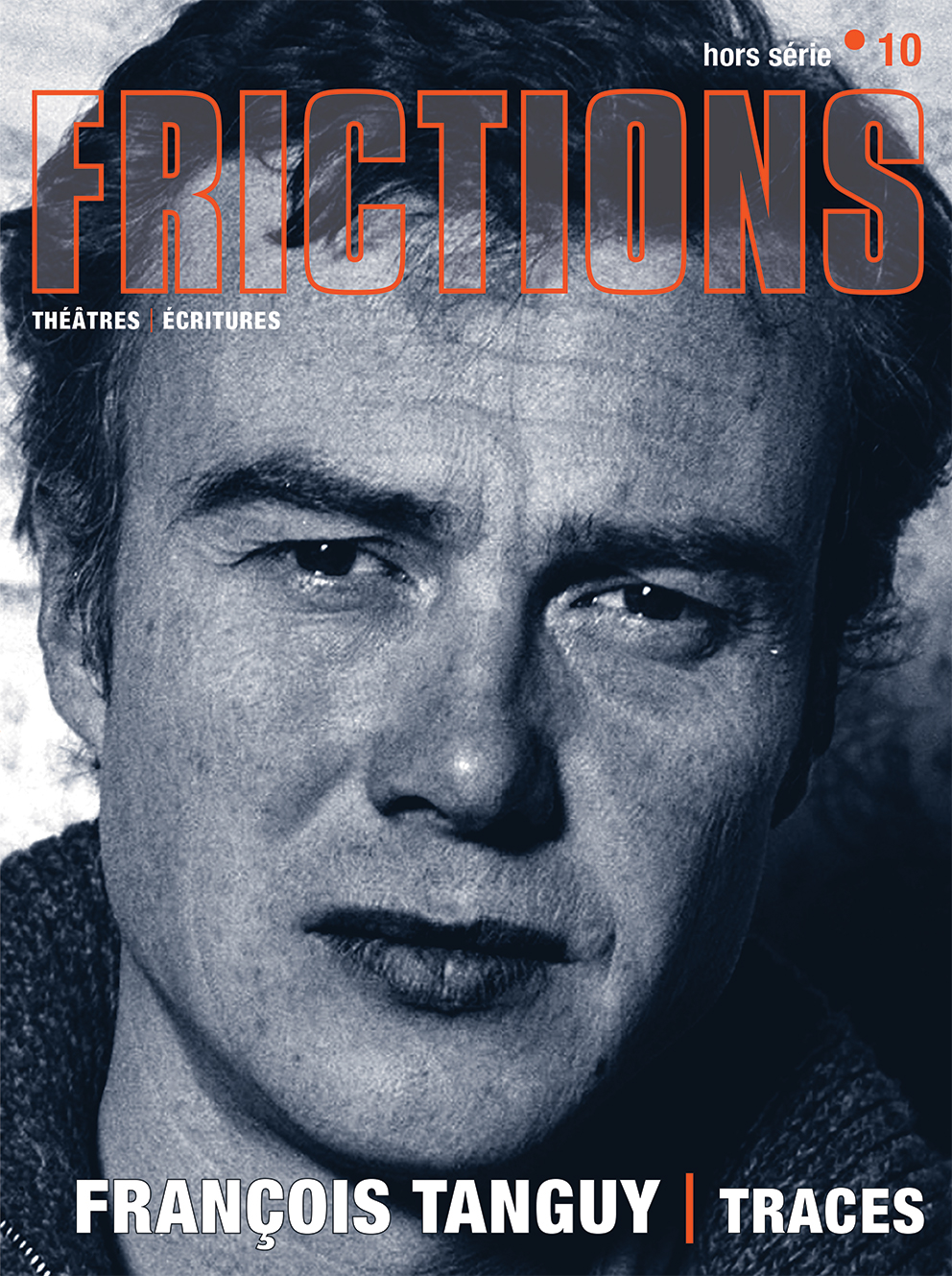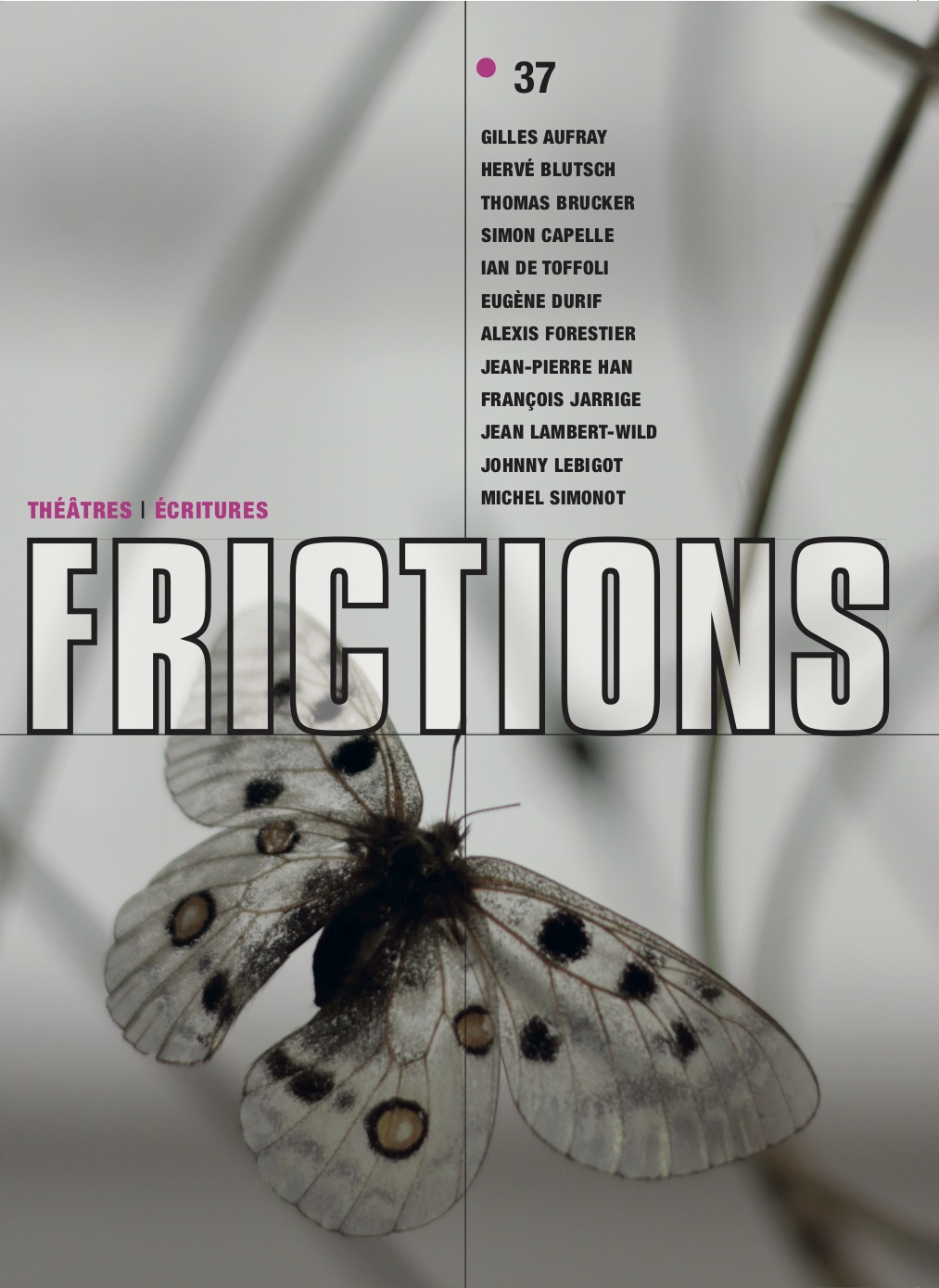Souvenirs d'Avignon
Le Festival d'Avignon avait cette année une saveur toute particulière. Toujours, et plus que jamais, placé sous l'égide de la figure désormais quasiment mythique de Jean Vilar dont on fêtait le centième anniversaire de la naissance, c'était l'avant-dernière programmation de l'actuel duo directorial Vincent Baudriller-Hortense Archambault prié de laisser la place à Olivier Py après un imbroglio comme savait si bien les provoquer l'ancienne équipe gouvernementale. Aurélie Filippetti, la nouvelle ministre de la Culture ayant, à juste titre, préféré laisser les choses (avignonnaises) en l'état, la présente édition avait déjà un air d'au revoir, une forme de salut presque final où l'on pourrait s'attendre sinon à un véritable feu d'artifice, du moins à un étalage d'un réel et brillant savoir-faire acquis au fil des ans (presque dix ; il y aura donc l'année prochaine encore un anniversaire à fêter en même temps que le départ définitif de l'équipe d'aujourd'hui !). Étaient d'ailleurs convoqués, pour cette 66e édition, quelques fidèles, Thomas Ostermeier qui fut le premier artiste associé, selon la formule inventée par Baudriller et Archambault, Christoph Marthaler, lui aussi ancien artiste associé, tout comme Josef Nadj ou encore Romeo Castellucci. Aucun risque de dépaysement donc avec ce très beau monde, même avec les nouveaux invités toujours triés sur le volet de la (post)modernité. Voilà pour l'annonce des préparatifs des festivités : restait, bien évidemment, à attendre le verdict de la réalité des plateaux…
D'hier à aujourd'hui Entre-temps, hommages, revendications de tous et de chacun de l'héritage de la personnalité tutélaire de Jean Vilar – rien que de très naturel –, avec cette précision d'Hortense Archambault selon laquelle « Jean Vilar a vraiment inventé le Festival d'aujourd'hui », ce qui, on le conviendra, est aller un peu vite en besogne. Le Festival d'aujourd'hui n'ayant plus rien à voir avec celui de son temps, du lendemain du conflit de la Deuxième Guerre mondiale à l'après mai 68, pour la simple et bonne raison que les conditions économiques et sociétales, ont sinon changé, du moins évolué de telle manière qu'aucune comparaison effectuée dans l'absolu ne saurait être valable. On ne reviendra pas sur les pertinentes analyses de Jean Jourdheuil que je me suis plu à citer maintes et maintes fois, concernant la marchandisation de l'art théâtral et notamment des festivals, entraînant une autre façon d'appréhender les spectacles, en soi ou les uns en rapport avec les autres. De ce point de vue, l'un des derniers discours, fin août, de notre ministre de la Culture, est pour le moins éclairant : concernant le Festival d'Avignon, elle signale et se félicite des 125 000 entrées (payantes ?) de cette année, un « important succès auprès du public » donc, et preuve irréfutable que « la culture est un atout économique essentiel pour notre pays ». Il aura tout de même fallu attendre 2009 pour qu'un colloque organisé en Espagne mette les pieds dans les plats et parle du théâtre, de l’économie de marché et de la liberté de création, essayant d'identifier les nouvelles donnes esthétiques théâtrales dans nos société libérales avancées et même un peu trop mûres, après qu'à Almada au Portugal, au Festival dirigé par Joaquim Benite, le sujet ait été évoqué à maintes reprises…
Parler du monde en crise Les réalités sociales et politiques du monde ? Mais les directeurs-programmateurs ne les ont certes pas oubliés, ils ne pensent même qu'à ça, disent-ils ! « Comme chaque année, … nous nous interrogeons sur le théâtre, sur ce qui le fonde ou l'inspire : la fiction, le réel, l'écriture dramatique ou littéraire, le corps, la peinture, le cinéma, la peinture, la musique, et aussi l'histoire, la philosophie, l'économie… » explique Hortense Archambault en parfait accord avec Vincent Baudriller qui détaille un peu plus loin, – liste des spectaclprogrammés à l'appui – ces propos. Nos deux complices n'en feraient-ils pas un peu trop ? Mais admettons. Il y eut donc de tout dans cette programmation avec effectivement toutes les « thématiques » annoncées, parcourant même, pour bien enfoncer le clou, plusieurs spectacles à la fois. On remarquera au passage, non sans sourire, un retour en force du texte et même du littéraire, alors que l'on se souvient de la fausse querelle du Festival de 2005 où les directeurs avaient été accusés de les avoir sacrifiés au détriment d'un théâtre d'images et de performances… Retour en force donc du texte « classique », de Boulgakov et de Tchekhov qui eurent droit à la Cour d'honneur du palais des papes, d'Ibsen et de Pirandello, sans compter que l'un des bénéficiaires de cette nouvelle donne fut Christophe Honoré, écrivain avant de devenir cinéaste et metteur en scène de théâtre. Christophe Honoré qui eut droit à tous les honneurs avec trois spectacles, l'un présenté (plutôt mal) par Éric Vigner (La Faculté), l'autre par Robert Cantarella (Un jeune se tue), avant que lui-même n'apporte sa propre vision du Nouveau roman, loin d'être inintéressante, à condition que l'on s'obstine pas à rechercher les véritables références littéraires du mouvement… Reste tout de même, pour ne point faillir à une certaine tradition du Festival, que tous les textes furent largement remaniés. Rien de plus normal pour Le Maître et Marguerite de Boulgakov qui est un roman, mais pour ce qui est de La Mouette de Tchekhov, véritablement tripatouillée, de Six personnages en quête d'auteur de Pirandello remis au goût du jour par le metteur en scène qui n'est pas un auteur, ou encore d'Un ennemi du peuple d'Ibsen remarquablement monté par Thomas Ostermeier dont c'est une habitude que d'agir ainsi, on peut légitimement se poser quelques questions. Encore que la « fidélité » de Katie Mitchell au roman de W. G. Sebald, Les Anneaux de Saturne, (texte récité et simplement « illustré », « sonorisé »), après quand même quelques coupes, fut tout aussi problématique…
Présenter un « théâtre en prise avec le réel », c'est la volonté quasi obsessionnelle affirmée de nos directeurs du Festival. Cela en deviendrait presque touchant, même si les résultats sont loin d'être probants. Le réel d'aujourd'hui, c'est bien entendu la crise, comme le réel des années quatre-vingt dix fut, au théâtre, celui de « la Misère du monde » et de la volonté affichée, en France, de « réduire la fracture sociale », avec les résultats plutôt décevants (c'est un euphémisme) qui en résultèrent sur les plateaux. La crise donc aujourd'hui, il en fut question dans les débats (« Comment penser et représenter la crise », se demandèrent les économiste Frédéric Lordon et André Orléan dans le Théâtre des Idées), dans la presse consacrée au Festival, Le Monde dans son supplément y alla de son enquête : « reflets et questionnements d'un monde en crise », et sur les plateaux avec notamment le 15% de Bruno Meyssat, intéressant mais pas vraiment convaincant si l'on connaît le travail de cet artiste singulier, abscons si on le découvre, et qui fait référence au « pourcentage espéré de retour sur fonds propres qu'attendent les fonds de pension ou les organismes de placement entrant dans le capital d'une entreprise », Meyssat dixit !? Obsession de la crise donc, et pourtant à voir la débauche spectaculaire, nouvelles technologies plus ou moins bien utilisées à l'appui, qui pourrait croire que le phénomène a touché le monde du théâtre ? Celui-ci continue à tourner (à ronronner) comme si de rien n'était. Et, paradoxal revers de la médaille consistant à tourner le regard vers l'extérieur, tous azimuts, le repliement et le regard sur soi. Soit le passage de l'ouverture à ce qui peut s'apparenter à une fermeture. Rien d'étonnant si l'une des autres thématiques récurrentes des spectacles présentés fut celle de la mise en abyme, de l'interrogation du théâtre sur soi. Ce qui est normal pour les Six personnages en quête d'auteur de Pirandello puisque c'est le sujet même de la pièce (dont la mise en scène de Stéphane Braunschweig fut franchement peu convaincante), mais pour les autres, présentation de La Mouette de Tchekhov comprise, dans un travail d'Arthur Nauzyciel qui en rajoutait jusqu'à plus soif ? Concernant ce dernier spectacle, nous eûmes même droit à un début de querelle entre critiques, les uns (dont je suis) trouvant la chose étirée à 4 heures et demie plutôt vaine et prétentieuse, les autres (ceux des « grands » journaux) criant tout de même pas au génie, mais à l'éblouissement poétique ! Un grain de piment dans une programmation mi-figue, mi-raisin, plutôt atone par moments, qui avait pourtant fort bien débuté avec trois spectacles, Le Maître et Marguerite signé Simon McBurney habilement mené dans la Cour d'honneur, et surtout avec La Négation du temps du sud-africain William Kentridge, superbe et intelligente méditation sur le temps (voilà qui n'est guère fréquent alors que le sujet est au cœur même de l'essence théâtrale), et My Fair lady, un laboratoire des langues dû à Christof Marthaler, que l'on pourra voir et revoir à la fin de l'année aux Ateliers Berthier à Paris. Pour la suite, mieux vaut la passer sous silence par pure charité (déceptions pour les « nouveaux et jeunes » Guillaume Vincent et Séverine Chavrier, comme pour les plus aguerris Eric Vigner ou Jean-François Matignon) avant qu'Ostermeier, je l'ai dit, ne vienne enfin nous réveiller avec Un ennemi du peuple tonitruant et appuyant là où cela fait mal, et alors que les colombiens du Mapa Teatro dans un spectacle, Los Santos inocentes, premier volet d'une trilogie, laissaient entrevoir une suite passionnante et percutante. L'an prochain peut-être que l'on attend avec impatience avec les deux nouveaux et derniers artistes associés, le congolais Dieudonné Niangouna et le français Stanislas Nordey.
Jean-Pierre Han
article paru dans Les Lettres françaises du 5 septembre 2012