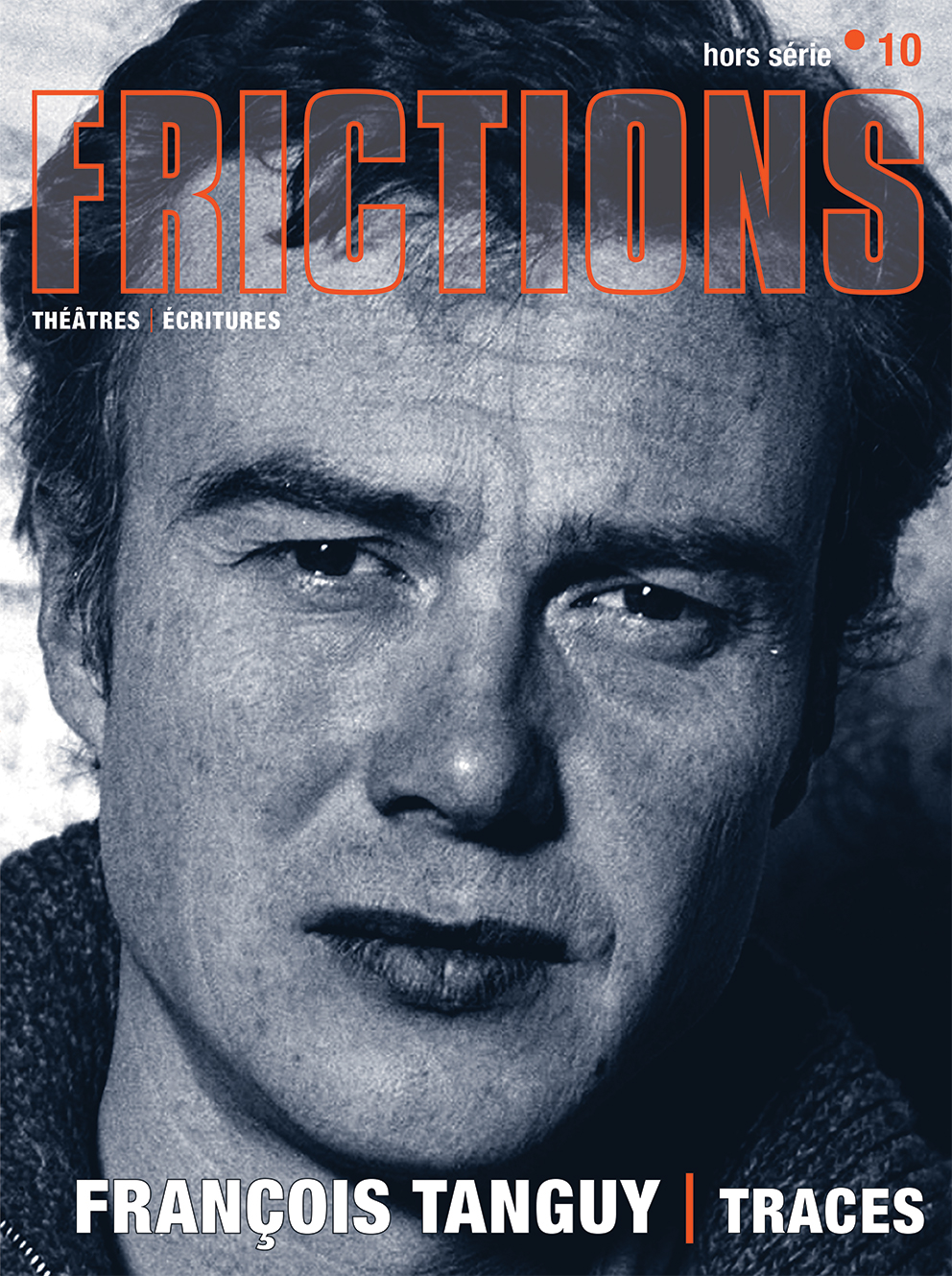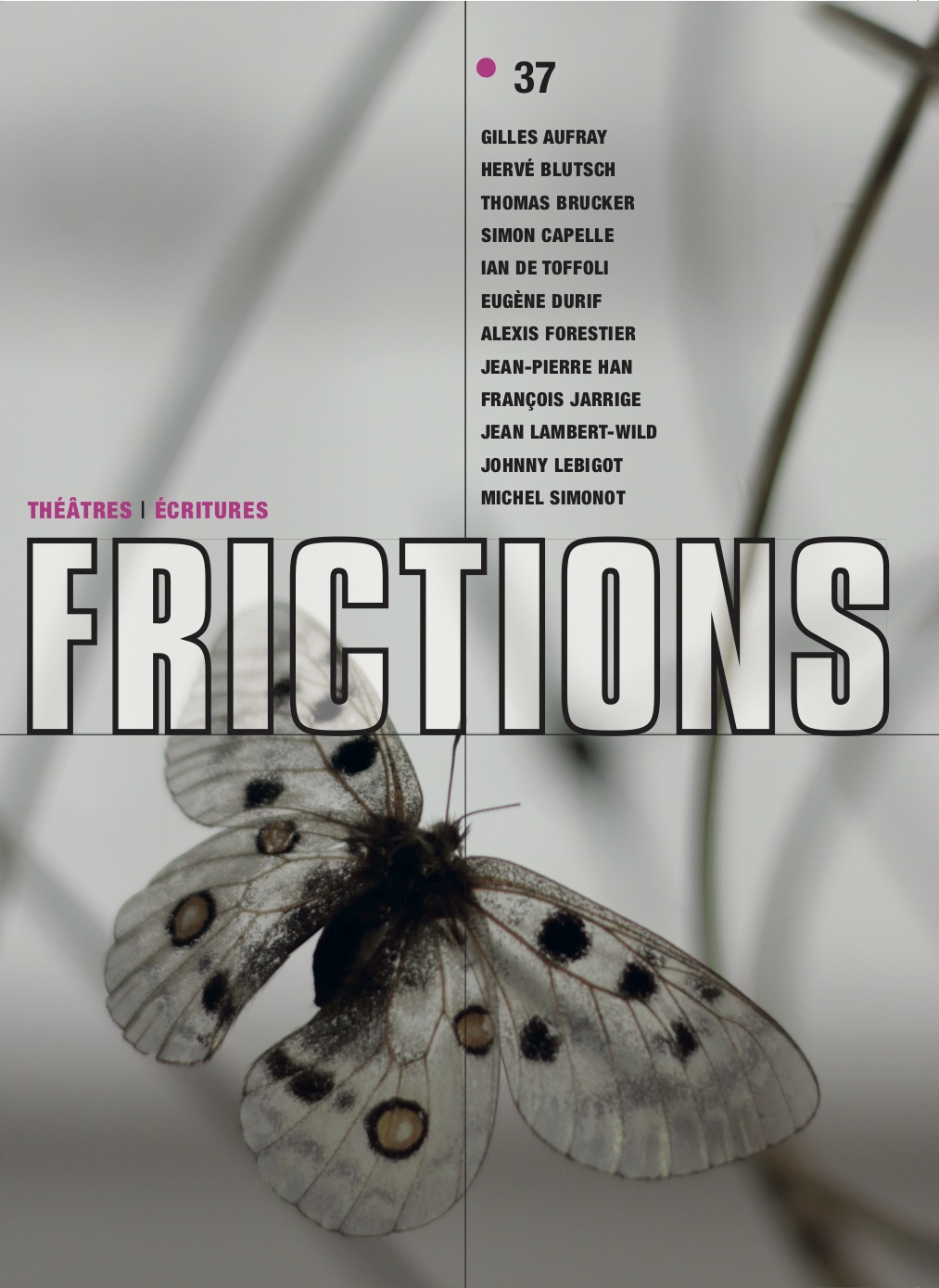Le spectateur humilié
Avignon, la ville. Avignon, le festival. Ces deux facettes finissent par se confondre, mais loin de la vision revendiquée par Jean Vilar et surtout loin d'une issue émancipatrice à leur confrontation.
La ville, tout d'abord. Au-delà d'un héritage historique ambigu, pour le dire sobrement, et qui alimente encore manifestement quelques atavismes dans la réception des spectacles par le public festivalier – on se souviendra tout simplement des réactions outrées au miroir tendu par l’événement de l'édition 2010, le Papperlapapp de Marthaler, incisif et pertinent y compris dans ses moments crispants, étirés jusqu'à l'exaspération des foules – au-delà de cet héritage, donc, la ville présente exactement le même visage que n'importe quel centre urbain après que l'économie y ait triomphé à la manière de Pyrrhus. Tout ce que les rues ont à exposer comme activités légitimes est d'ordre commercial et, en arrière-plan, industriel. Les vitrines climatisées et les terrasses limonadières intra muros, les affichages publicitaires démesurés hors les murs, partout triomphent les nécessités de la valorisation sonnante et trébuchante.
Pour la plupart des passagers de la navette entre la porte Saint-Michel et la salle polyvalente de Montfavet, le trajet – dont on nous rappelle mesquinement sur le ticket que le coût (plutôt élevé, 4,50 €) est partiellement pris en charge par une collectivité locale associée au festival : un espace vide est forcément un espace perdu pour la communication promotionnelle – le trajet, donc, se fait le nez plongé dans le supplément « festival » d'un quelconque magazine culturel ou avec le regard éteint. Il est vrai que le paysage y est moins emprunt du charme discret de la bourgeoisie qu'en centre ville et que les ravages de nos sociétés avancées y sont trop trivialement visibles. Quant à la zone déshumanisée où l'on aboutit après vingt minutes d'apnée mentale, il n'y a guère que ceux qui auront jeté un œil lucide sur une plaquette de la municipalité pour se souvenir, apprendre ou déduire, en passant, qu'elle a poussé sur la décomposition d'un monde paysan encore aux portes de la ville à l'époque où Jean Vilar l'y invite, avec d'autres, à transgresser les rapports de classe.
Le centre ville, où la richesse se concentre pour se mettre à l'abri des nuisances les plus criantes, pourrait sembler préservé de cet urbanisme fonctionnel. Mais cette illusion vole spectaculairement en éclats au moment du festival. La reconstruction générale du monde sous la poussée des logiques économiques lance son branle-bas de combat. Les salles se louent sans vergogne, les supports divers et variés se couvrent d'une lèpre qui ne doit rien à la spontanéité, les parades exhortent à rendre le tout financièrement viable par un remplissage minimum. Ce qui s'exprime en temps normal sous la forme de la pacification requise pour la bonne marche des affaires devient le moteur d'une exubérance dans laquelle les revendications festives, esthétiques ou subversives ne sont plus que des utilités marginales. Ceux qui se déplacent à Avignon le temps du festival pour y rentabiliser leurs investissements n'ont pas d'autres objectifs que ceux qui s'y activent toute l'année. Un même ressort anime ces deux figures de la ville et au-delà de la concurrence pour exister dans l'espace public, tous s'accordent sur la permanence des règles du jeu. Dans la physionomie de la ville, durant le festival, tout change pour que rien ne change.
Faut-il blâmer le festival de produire le monde tel qu'il ne va pas ? Certes non, cependant il ne faut pas éluder le fait qu'il tend à le reproduire. De fait, l'organisation actuelle du festival entérine cette dépendance de tous les aspects de nos vies aux catégories de l'économie, jusqu'à importer en son sein les pratiques et les discours managériaux qui naturalisent cette situation. On ne mord pas la main qui nourrit, dit-on... mais il faudrait au moins se poser quelques questions quand elle nous empoisonne. Aujourd'hui l'échec ou la réussite d'un festival se mesure principalement au fait que la réalisation budgétaire est en ligne avec les projections. Celles-ci sont acceptées comme des données, des contraintes quasi naturelles dans leurs formes et leurs degrés. On ne cherche donc plus à tracer des pistes hors de ce cadre, juste à le parcourir plus efficacement. « Il n'y a pas d'alternatives » était un slogan révoltant, il y a trente ans. C'est devenu le plus sûr des fondements dans la tête de ceux qui prétendaient pourtant le démentir. La question du faire ensemble est réduite à comment faire avec – toujours trop peu, c'est inévitable dans ce jeu-là – et non plus comment faire autrement. L'argent est le nerf de la guerre... et de la culture telle qu'elle se revendique aujourd'hui dans les institutions. Un relent de conscience sociale ne peut alors se manifester que sous la forme de l’aumône. C'est l'absolution recherchée par la mise en place de tarifs préférentiels pour les populations « défavorisées ». Ce ne sont pourtant que des pis-aller au fait d'avoir accepté comme inéluctable qu'une communauté publique, même temporaire, se fonde uniquement sur une contribution économique. En bout de chaîne, cette logique unidimensionnelle se traduit par la suspicion qui pèse sur le festivalier devant certifier en long et en large son statut – et donc la situation qu'il subit – pour accéder aux faveurs qu'on lui concède. Entre autres exemples, retirer ses billets pour un allocataire du RSA est un épisode supplémentaire de son parcours d'obstacle administratif : il faut montrer patte blanche. Après la guerre, c'est la police qui façonne un nouvel aspect du festival.
Les avatars d'Avignon s'accumulent et nourrissent une sorte de honte prométhéenne où les impératifs économiques auraient le rôle de perfection intimidante et fatidique que Günther Anders attribuait aux machines. Nous voilà, enrôlés dans cette mécanique à qui nous déléguons nos responsabilités, impuissants à la dévier de sa trajectoire catastrophique et en rage de lui avoir donné notre énergie.
Pour celles et ceux qui accordent encore quelque attention – même critique – aux propositions de Jean Vilar, Avignon est devenu l'autre nom de l'humiliation.
Eric Arrivé