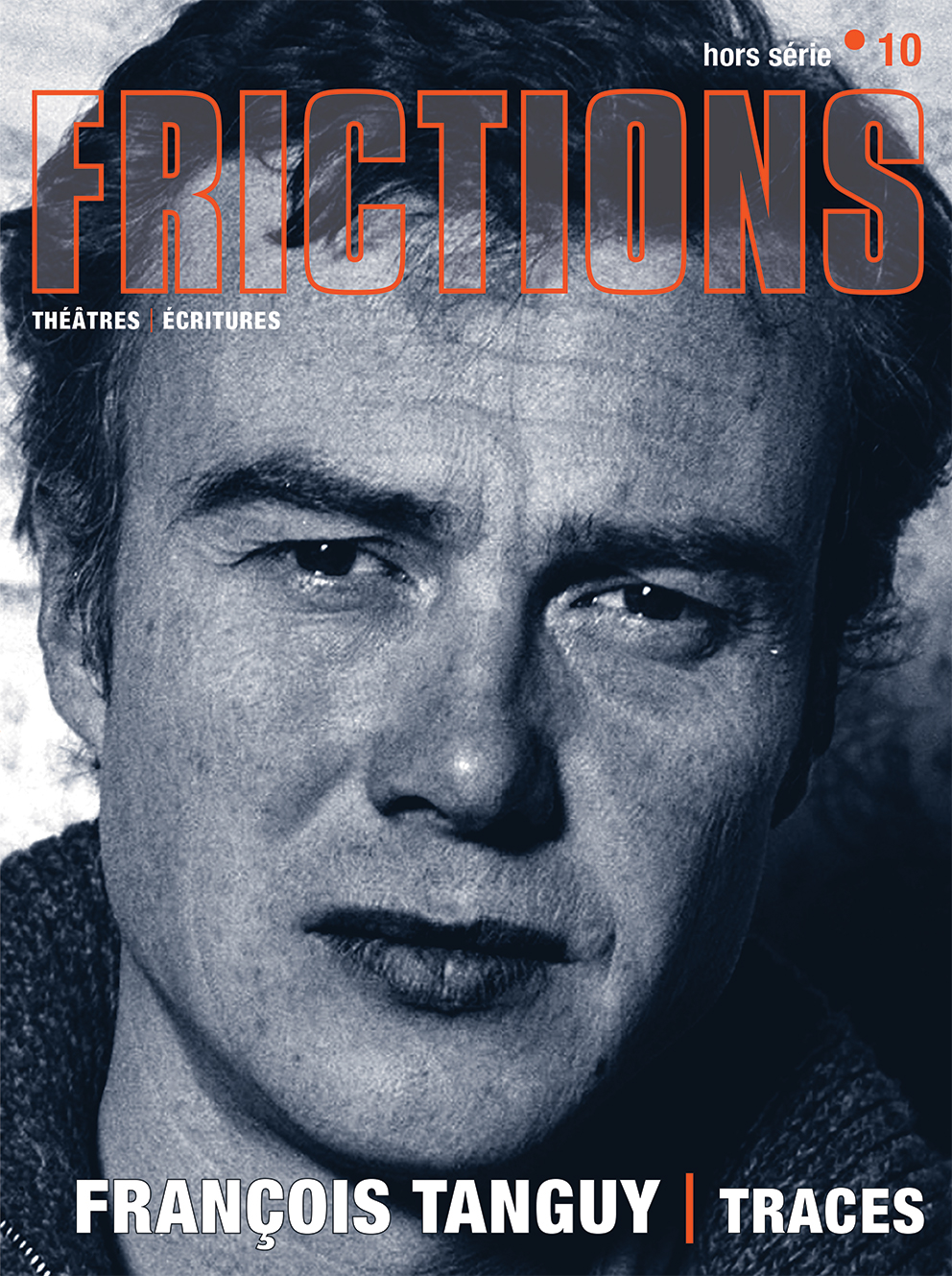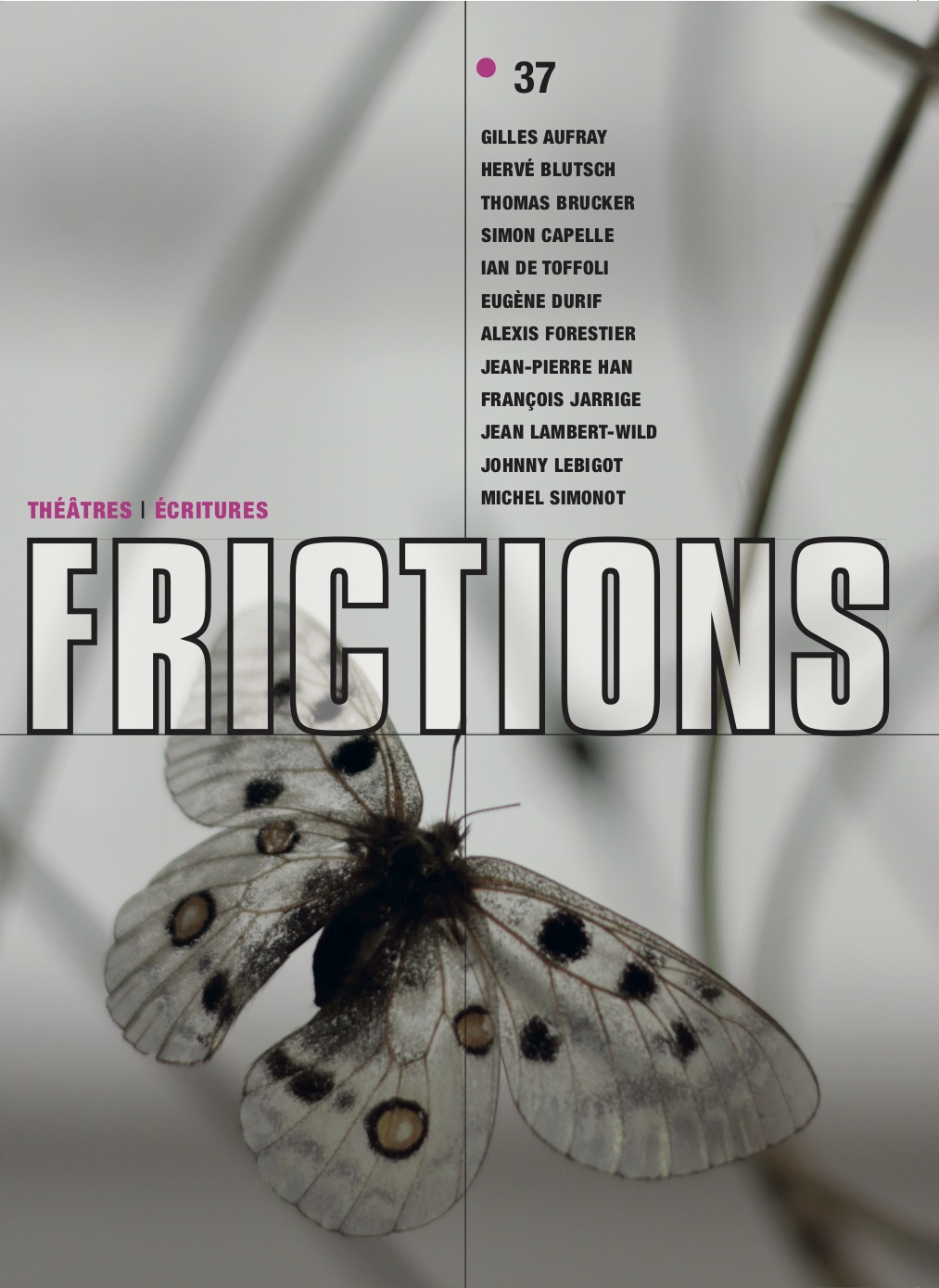De l'excellence artistique
Excellence : degré éminent de perfection qu’une personne, une chose, a en son genre.
Avec une majuscule : titre honorifique donné aux ambassadeurs, ministres, archevêques, évêques.
Le Petit Robert
Les temps sont durs. Qu’importe ! Tête haute, affrontons l’avenir qui, tout le monde le sait depuis Karl Valentin, était pourtant meilleur autrefois. Et remettons au goût du jour le concept (mot qui, de la sphère philosophique, est tombé dans le registre commercialo-publicitaire) d’excellence artistique. Il n’est en effet plus question que de cela : de cette fameuse excellence artistique. L’exemple, c’est logique, vient d’en haut. Notre actuel ministre de la culture a, lui aussi et comme de bien entendu, recours à ce concept. Personne ne songerait à le lui reprocher. Il faut donc que nos théâtres nationaux, nos centres dramatiques toujours nationaux fassent dans l’excellence artistique : c’est leur mission nous dit-on. Nul doute que dans le prochain « texte fondateur » concernant « l’existence d’une mission nationale de soutien au spectacle vivant, commune à l’État et aux collectivités locales » promis par Jean-Jacques Aillagon dans une tribune publiée dans Le Monde du 24 mai dernier il sera fortement question de l’excellence artistique. D’ailleurs dans le même article il est bien question de « critères d’excellence » qui distingueront désormais les « Festivals d’intérêt national » (nouveau label au relent sémantique pour le moins étrange et qui entrera en vigueur dès 2004) du …reste commun et vulgaire. Je ne m’appesantirai pas sur le paradoxe de cette « excellence » saisie au cœur d’un développement tendant à « combattre l’inégalité culturelle française » (c’est le titre du « point de vue »), pour ne m’en tenir qu’à une tentative d’explicitation de l’expression indiquée.
Qu’est-ce que l’excellence artistique en matière théâtrale, et depuis quand le concept fait-il florès ? Qui sont les heureux bénéficiaires de ce nouveau label ?
J’associerai volontiers l’émergence de l’excellence artistique à ce que Jean Jourdheuil, il y a une dizaine d’années, et avec beaucoup de pertinence, nommait La Dérive spectaculaire (voir ses articles parus dans Libération des 15, 16-17 juillet 1994, repris et corrigé dans Théâtre et spectacle, hors série n° 3, mars 1995 de la revue Du théâtre). Sans doute faudrait-il reprendre ici son analyse de la situation théâtrale d’alors. Analyse que l’on aurait été bien inspiré de prendre comme un signal d’alarme, mais la logique mercantile a, bien sûr, d’autres (et très antagoniques) priorités. Jourdheuil opérait en particulier une distinction radicale entre le théâtre, « affaire de la Cité et des citoyens » et les spectacles « affaire de clientèle (électorale ou autres)… » Et si ses exemples opposaient Les Paravents de Jean Genet créés à l’Odéon en 1966 à l’apothéose mitterrandienne au Panthéon en 1982 ou encore au défilé Goude pour commémorer 1789, s’il continuait à opposer le théâtre grec au théâtre romain, parlant du spectacle asséné par la télévision, il finissait quand même par en arriver au théâtre de notre époque pour constater que : « C’est un abus de langage de considérer aujourd’hui les mises en scène des classiques comme du théâtre. Il est passé le temps où l’on pouvait faire, à l’instar de Planchon, Chéreau, Strehler, du théâtre en montant Molière, Marivaux ou Goldoni. Aujourd’hui, ce n’est plus que du spectacle … ». C’est en ce point précis (et avant que Jourdheuil n’aborde la question du théâtre et de son histoire « arrêtée, selon lui, au milieu des années 70 ») que se niche sans doute le concept d’excellence artistique, un label que l’on peut appliquer aujourd’hui au même (enfin tout à fait justement !) Chéreau cité par Jourdheuil.
Il faut relier l’excellence artistique – cette étiquette apposée sur un produit – à la nouvelle et trépidante circulation des spectacles, russes, américains, polonais, hongrois, espagnols, etc. Ce dont tout le monde ne peut que se réjouir. Mais cette extraordinaire ouverture a son revers : les spectacles présentés doivent bien évidemment être « excellents », ce dont tout le monde continue à se réjouir ! Cette excellence vagabonde a ses exigences. Barrière de la langue plus ou moins surmontée (les techniques de surtitrage en particulier s’améliorent), il est préférable que la dramaturgie et les images soient repérables. La prise de risque, si prise de risque il y a, doit également être minime. On saisit bien la dynamique de ces spectacles : toujours plus vers le convenu (le repérable), l’accroche lisse. Poussée jusqu’au bout, la logique nous mène tout droit vers un art officiel (par-delà les frontières). Les organismes filtrants sont d’ailleurs là pour faire les gendarmes, car il y va toujours de l’ « image » du pays producteur. Ou alors il faut jouer l’écart au maximum, classer le spectacle dans une catégorie ésotérico-folklorique… Jourdheuil encore : « Je ne suis pas sûr que cette ouverture de l’esprit, cette intégration (un peu superficielle il est vrai) d’identités diverses ne soit pas l’occasion d’une abolition des identités dans un relativisme généralisé et que les spectacles en question ne nous procurent qu’un dépaysement routinier »… Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de nier la qualité, la valeur de certains spectacles ainsi présentés, mais il n’empêche que dans leur majorité ce qu’ils proposent (véhiculent) ne sont rien moins que des esthétiques recyclées (on puise beaucoup ces temps-ci dans l’esthétique des années 70, de Jan Fabre à Rodrigo Garcia), ou de véritables produits manufacturés, « polis » par quelques assistants zélés formés à cette tâche (voir certains spectacles de Bob Wilson), frôlant parfois le son et lumière chic et toc comme chez Purcarete. Alors oui « ces spectacles se présentent aux spectateurs comme des marchandises sur les rayonnages d’un supermarché, dans ce que Heidegger appelait une “uniformité sans distance“, animée seulement par des campagnes de promotion ». Campagnes de promotion relayée avec plaisir par les médias qui, de leur côté, n’ont d’autres soucis que de couvrir l’« événement », de gagner du lectorat et des parts de marché… L’événement, c’est, dans ces conditions, en France, la rentrée théâtrale de Juliette Binoche aux Etats-Unis, la tournée de Zingaro dans le même pays (une pleine page dans Le Monde !), c’est rendre compte d’un livre de Luc Bondy écrit en allemand et non traduit (toujours dans Le Monde), etc. au détriment de la production « courante », forcément vulgaire et négligeable.
Pour qu’un tel système fonctionne il faut bien sûr un minimum d’organisation et de connivence. Jetez un coup d’œil sur les co-producteurs des gros et excellents spectacles, vous serez édifiés : les festivals de réputation internationale (faudra-t-il songer à un label « festival d’intérêt …international » ?) s’y taillent la part du lion, à côté de très grandes institutions nationales : la Phèdre de Patrice Chéreau est ainsi co-produite par le théâtre national de l’Odéon-théâtre de l’Europe et la Ruhrtriennale, le Wiener Festwochen de Vienne ayant par ailleurs immédiatement programmé (pré-acheté ?) le spectacle. Quant aux soutiens officiels…
Voilà pour le haut de gamme qui peut encore malgré tout procurer certains émois, encore que les véritables enjeux esthétiques et donc politiques de notre temps n’y ont plus droit de cité. Dès lors le spectateur se retrouve dans une position « muséographique ». Bien pire est l’effet d’exemplarité de ces toujours luxueuses productions (il serait intéressant de parler chiffres en ces temps de misère) sur de plus jeunes générations qui n’auront de cesse que d’imiter leurs glorieux aînés. Voir donc des jeunes d’une trentaine d’années (et un peu plus) nous proposer des produits déjà lisses, manufacturés, bien, trop bien fabriqués – pas un grain de poussière ne viendra jamais gripper le bon déroulement du spectacle (il faudrait faire l’éloge de l’imperfection et de la saleté !) – est simplement effrayant
L’excellence artistique en matière théâtrale a engendré une caste très fermée réunissant très peu d’élus. C’est elle, bien sûr, qui impulse et impose une esthétique majoritaire aux multiples facettes. Conscient du danger Jean-Marie Piemme, dès 1991, réclamait « le plus d’esthétiques minoritaires possibles » faisant le constat qu’ « aujourd’hui le théâtre n’occupe plus le centre de la vie collective. Il est devenu un art minoritaire », d’où la volonté de contourner cette situation en avalisant le consommable. Piemme ajoutait que « si l’internationa-lisation (avec ce que cela suppose de gommage d’identité) et les noces médiatiques devaient constituer les fers de lance d’une esthétique dominante du théâtre européen, mieux vaudrait renoncer »<ref>Jean-Marie Piemme : Le plus d’esthétiques minoritaires possibles. Cahiers de la Comédie-Française, n° 1. Automne 1991.</ref>. Douze ans plus tard nous y sommes bien, mais pas encore question de renoncer. « Quelque chose disparaît et le nouveau n’a pas fait son apparition »… notait de son côté, dubitatif, Jourdheuil. Pour l’heure le nouveau n’a toujours pas fait son apparition, mais l’excellence artistique nous sert d’alibi.
Ce concept d’excellence artistique a ceci d’intéressant qu’il permet, d’emblée, d’évacuer tout regard (et a fortiori toute parole) critique sur les produits qui ont l’immense chance d’être classés dans sa catégorie. Les « auteurs » de ces produits deviennent même des intouchables. Imagine-t-on un vulgaire plumitif, ou un artiste de seconde zone, émettre la moindre remarque désagréable sur Klaus-Michael Grüber, Peter Stein, Bob Wilson and c° ? Imagine-t-on les mêmes crier au scandale lors de la prestation de Michel Piccoli au Conservatoire dans Les Géants de la montagne de Pirandello justement mis en scène par Grüber ou s’étonner du travail de Chéreau la même année, et toujours au Conservatoire, sur Shakespeare où l’on ne voyait que Philippe Calvario qui ne faisait pas partie de la promotion concernée ? Malheur à qui ose s’attaquer à la belle machine, d’autant que la mondanité est un relais parfait de la caste et qu’entre gens de bonne compagnie on est toujours solidaire…
L’excellence artistique a le bon goût donc de clore la moindre velléité de débat. Pourquoi d’ailleurs y aurait-il débat ? Les produits sont finis, figés dans leur perfection. Une fois pour toutes. Nous sommes aux antipodes des notions d’œuvre ouverte, aux antipodes de toute expérimentation qui seule permettrait au théâtre de reprendre, peut-être, le cours de son histoire en réintégrant l’Histoire.
Jean-Pierre Han
frictions, n° 7, été 2003. Repris dans Derniers feux, ed. Lansman, 2008.